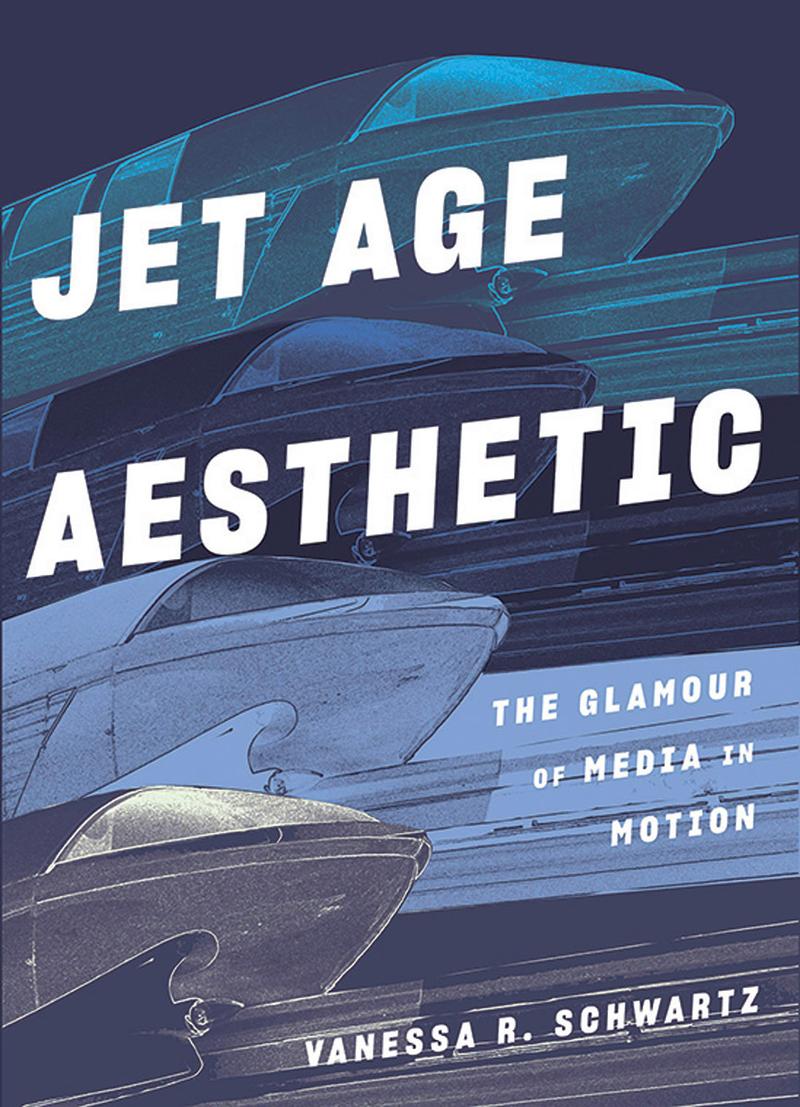
Arrivant à un moment de l’histoire du tourisme où les compagnies aériennes proposent de s’envoler vers nulle part, le nouvel ouvrage de Vanessa R. Schwartz nous invite à nous demander ce qui, à défaut de destination, nous motive encore à prendre la voie des airs. L’interrogation semble d’autant plus légitime que, selon l’auteure, la qualité de mouvement qui a été activée et cultivée par le transport aérien, depuis l’avènement du jet qui l’intéresse ici, est celle d’une absence de sensation de mouvement, soit précisément « l’impression d’aller nulle part » (p. 19). Cette contradiction d’un déplacement qui devenait extrêmement rapide en même temps qu’il se faisait quasiment imperceptible, Schwartz propose de la saisir dans la notion de « mouvement fluide » ; mais loin de s’en tenir à l’expérience subjective du vol en avion à réaction, elle étend aussitôt l’application de cette notion à une variété d’objets dans lesquels elle situe – c’est l’un des tours de force de l’ouvrage – cette même qualité de mouvement. L’étude de Schwartz s’emploie ainsi à définir et à localiser une esthétique propre à l’ère du jet, qui s’est déployée dès le milieu des années 1950 à travers différentes configurations spatiales et médiatiques.
Si le voyage aérien a récemment suscité son lot de publications novatrices dans le champ des études visuelles, celle de Schwartz vient, tant par la méticulosité de ses recherches que par l’acuité de ses hypothèses, former un cadre pour penser, plus largement, ce que l’auteure appelle une « culture des médias en mouvement » (p. 12). Adossé sur l’ouvrage de référence de Wolfgang Schivelbusch1, le livre de Schwartz se place aussi résolument dans le prolongement des travaux d’Anne Friedberg, de Giuliana Bruno et des siens propres2, autant de jalons dans l’exploration des relations entre médias et mobilités, au sein d’espaces emblématiques de la modernité : parcs d’attractions, expositions universelles, grands magasins, etc. Elle y trouve au moins en partie sa méthode de navigation fluide entre les médias, non seulement la photographie, le cinéma et la télévision, mais aussi les transports qu’elle définit comme tels. C’est également dans sa méthode d’investigation patiente et persévérante à travers les archives que l’ouvrage puise son pouvoir de conviction, car Schwartz réussit à faire resurgir la fluidité là où l’on serait souvent tenté de ne percevoir que de la fixité. L’analyse des discours posés par des penseurs contemporains de l’avènement du jet, comme le critique d’art Lawrence Alloway et l’historien Daniel J. Boorstin, la conduit enfin à appréhender les déplacements conceptuels impliqués par ses objets.
Ainsi en va-t-il du premier chapitre où Schwartz interroge l’objet le plus directement lié à l’aviation, l’espace de l’aéroport tel qu’il a été repensé pour le jet par un architecte comme Eero Saarinen3. Plans, mémos, lettres, rapports et films institutionnels à l’appui, elle démontre que le prob-lème posé par l’architecture des nouveaux aéroports a eu moins à voir avec la recherche d’un futurisme ou d’un monumentalisme de l’environnement bâti qu’avec l’idéal d’une mobilité ininterrompue et interconnectée. En ce sens, Schwartz situe l’impact du mouvement du jet à deux niveaux : d’une part, l’expansion du transport aérien exige de concevoir l’aéroport comme un espace en constante transformation et d’intégrer, dans le projet architectural même, l’idée d’obsolescence ; d’autre part, la vitesse atteinte par le jet oblige à aligner la mobilité terrestre sur un modèle aérien qui vient redéfinir la notion de rapidité. En d’autres termes, il s’agit d’abord, pour les architectes engagés dans la construction ou la refonte des aéroports, de produire et de façonner de la fluidité. Dans son analyse de l’aéroport d’Orly (1961) qui est devenu dès sa création « une destination en soi » (p. 49), Schwartz avance – autre proposition-clé de l’ouvrage – que la qualité fluide du mouvement s’est immédiatement constituée en attraction.
L’attraction du mouvement qui s’était déplacée, au début du siècle, vers les écrans de cinéma et d’autres dispositifs de « voyages virtuels », semble aussi faire son retour dans le domaine de l’espace avec l’ouverture de Disneyland au milieu des années 1950, mais sous cette forme renouvelée : celle d’une mobilité caractérisée par la sensation de glissement dans l’espace. Prenant ses distances avec les approches de Disneyland axées sur la critique de la simulation ou de la consommation, Schwartz propose dans son deuxième chapitre de revenir aux archives de la compagnie pour faire apparaître la force structurante du « mouvement fluide », dans la vision des concepteurs du parc comme dans l’expérience des visiteurs. Elle dresse alors le portrait d’un Walt Disney – et d’une compagnie – maîtrisant aussi bien la création d’histoires, de personnages et de mondes imaginaires que les questions de mobilité, de gestion des flux et d’aménagement du territoire posées par les grands chantiers entrepris à la fin de sa vie par Disney. À Disneyland, l’enjeu du transport n’a pas seulement été central dans la section thématique du parc tournée vers le futur (Tomorrowland), c’est le parc tout entier qui a été fondé sur le mouvement d’un public de masse auquel il a offert le spectacle de sa propre mobilité.
Alors que l’impression de flottement dans l’espace est devenue accessible au plus grand nombre dans le parc d’attractions, elle a constitué l’expérience usuelle d’une minorité de voyageurs toujours sur le départ, et connue sous le nom de jet set. En enquêtant dans son troisième chapitre sur ce groupe social aux limites pour le moins mouvantes, mais dont les membres ont partagé un statut défini par la mobilité aérienne, Schwartz approfondit brillamment la réflexion sur les interactions entre voyage et image. L’un ne va pas sans l’autre en effet : l’apparition de cette « élite mobile » (p. 102) qu’est la jet set tient autant à l’avènement du transport aérien qu’à la circulation des images dans les magazines – pour les photographes, la mobilité aérienne a pu d’ailleurs être synonyme de mobilité sociale. Si l’étude de Schwartz s’articule autour de la vitesse de déplacement des photographes et des photographies à l’ère du jet, elle prend le soin de mesurer cette accélération à l’aune d’une histoire du transport des images, des preneurs d’images et de leur matériel de production. La photographie de presse, défend-elle enfin dans cette partie, fait souvent la chronique des événements du monde autant qu’elle raconte sa fabrication, soit une histoire de mouvement.
Ce questionnement sur l’image de presse se poursuit dans le quatrième chapitre, centré de manière plus monographique sur l’œuvre du photographe Ernst Haas. Objet délaissé de la culture visuelle du XXe siècle, la photographie en couleurs destinée à des magazines tels que Life est ressaisie ici par Schwartz au regard des nouvelles pratiques du journalisme, mais aussi des potentialités esthétiques de la couleur quant à la transmission d’une sensation de mouvement. Attiré par le maniement de la couleur à un moment où celle-ci était encore regardée comme une nouveauté troublante si ce n’est dérangeante, Haas s’est fait une spécialité des pérégrinations photographiques – on pense alors à une nouvelle sorte de flâneur –, dont il a rapporté de sensationnelles images. Compulsant les archives personnelles de Haas, Schwartz met en relation les images et les réflexions d’un photographe qui était moins attaché à la reproduction de figures ou de paysages reconnaissables qu’à la restitution de ses expériences subjectives du mouvement au moyen de la couleur. Dans un dernier déplacement caractéristique de l’ouvrage, Schwartz retourne au cinéma qui fut aussi, mais dans une moindre mesure, un terrain d’expérimentation de la couleur pour Haas avec le film The Bible (John Huston, 1966).
Lorsque nous serions incliné à diviser le livre en deux parties – la première serait consacrée aux espaces, la seconde aux images –, le propos de l’auteure vient sans cesse nous rappeler, comme le laissait déjà entendre le titre, que le mouvement fluide qu’elle traque au fil des pages est plutôt le produit d’interactions entre des mobilités et des visualités. La volonté initiale de considérer les images comme des forces plutôt que comme des produits ou des reflets est réaffirmée non seulement par l’iconographie choisie et la mise en page expressive de l’ouvrage, mais aussi par des passages éloquents sur des films institutionnels ou promotionnels qui, à l’instar de Walt Disney exposant, baguette à la main, le projet EPCOT dans The EPCOT Film (1966) (p. 96), visent à donner forme à une vision et à mettre en branle des chantiers. L’ère du jet telle qu’elle est revisitée par Schwartz s’impose en fin de compte comme un moment incontournable de l’histoire des médias, y compris pour la pensée des développements ultérieurs en direction d’une culture numérique au sein de laquelle la fluidité semble pleinement intégrée.
Référence : Stéphane Tralongo, « Vanessa R. Schwartz, Jet Age Aesthetic. The Glamour of Media in Motion, 2020 », Transbordeur. Photographie histoire société, no 5, 2021, pp. 184-185.