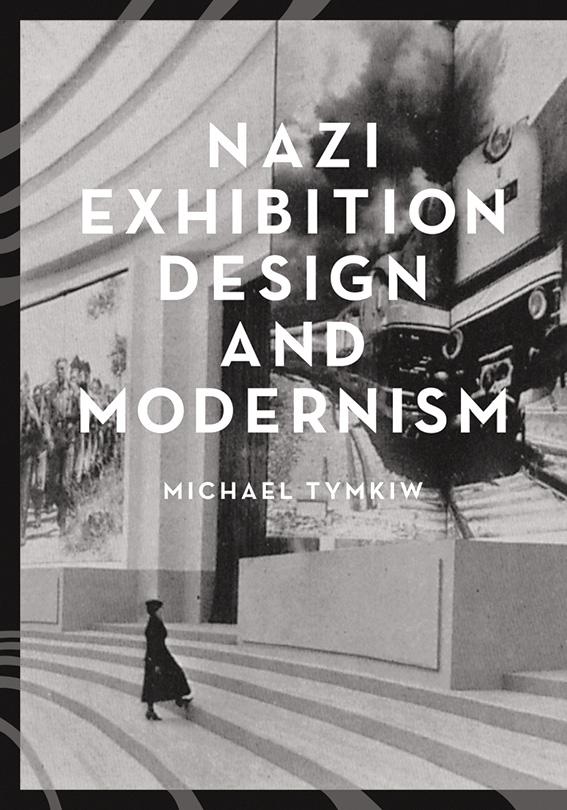
Les expositions des régimes totalitaires de l’entre-deux-guerres occupent une place notable dans l’historiographie de la scénographie d’exposition, comme si leur exemple exacerbait les pouvoirs de cet art à agir sur les consciences et par là l’importance de le soumettre à une analyse formelle et historique serrée. Cela vaut notamment pour les grandes machineries de propagande du IIIe Reich et tout particulièrement pour les usages de la photographie et du photomontage en leur sein. Les spécialistes de ces domaines ont en effet joué un rôle prééminent dans les recherches sur ces expositions, depuis les études pionnières de Benjamin Buchloh, Wolfgang Kemp ou Ulrich Pohlmann dès le tournant des années 1980 jusqu’à l’anthologie de Jorge Ribalta, Public Photographic Spaces. Propaganda Exhibitions, from Pressa to The Family of Man, 1928-55 en 2009. Une question a particulièrement dominé leurs travaux : la manière dont les formes et techniques d’exposition développées par les avant-gardes constructivistes des années 1920, d’El Lissitzky aux membres du Bauhaus, furent réprimées, reprises ou transformées par les régimes totalitaires, qu’ils soient national-socialiste, fasciste ou stalinien.
S’agissant du IIIe Reich, la thèse d’une rupture nette – et par là d’une incompatibilité ontologique – entre esthétique moderne et idéologie nazie a depuis longtemps été démontée comme un mythe forgé dans l’aprèsguerre, difficilement tenable en regard du caractère sinueux de maints parcours biographiques et de la remarquable adaptabilité des formes à des contextes changeants. Le consensus s’est dès lors plutôt établi autour de l’idée d’une perpétuation de certaines formules scénographiques sous le nouveau régime, mais dévoyées et monumentalisées avant leur abandon au profit d’un retour aux arts plus traditionnels à la fin des années 1930. Nazi Exhibition Design and Modernism de Michael Tymkiw, première étude générale sur la scénographie d’exposition durant la période national-socialiste, reprend et réinterroge certaines de ces positions, pour y apporter nombre de nuances ou de correctifs importants.
À son tour, Tymkiw souligne d’abord la nécessité de dépasser le mythe d’une avant-garde héroïque bannie du jour au lendemain par le retour de formes unanimement conventionnelles, mythe qui visait à établir une relation nécessaire entre innovation formelle et progressisme politique d’un côté, entre idéologie réactionnaire et conservatisme esthétique d’autre part, afin d’immuniser le modernisme et ses représentants contre tout soupçon de compromission idéologique. L’histoire, on le sait, a montré des intrications autrement plus complexes. Dès la première phrase de l’ouvrage d’ailleurs, Tymkiw n’hésite pas à parler d’« approches expérimentales de la scénographie d’exposition dans l’Allemagne nationale-socialiste » (p. 1) pour nous inviter à déconstruire ces associations trop rapides et nous confronter, pour reprendre les mots de son épilogue, à «ce que l’on pourrait appeler l’ambivalence, voire la promiscuité idéologique des formes » (p. 238), soit leur capacité à être mises au service de projets politiques radicalement différents.
Cela l’amène notamment à remettre en question une idée sousjacente à la plupart des études sur la question – y compris chez l’auteur de ces lignes –, celle du basculement, à partir de 1933, d’un spectateur moderne supposé « actif » – le terme est utilisé par Lissitzky lui-même – au visiteur présumé passif et subjugué d’une exposition de propagande totalitaire. Tymkiw souligne de façon convaincante le caractère simplificateur de cette polarité et l’importance persistante de la « participation » dans les expositions nazies – une « participation » qui, découplée de toute visée d’émancipation du spectateur individuel, a pu devenir dans ce cadre partie intégrante d’un projet d’enrégimentement, dès lors qu’il s’agissait d’appeler les visiteurs à prendre part aux changements culturels, politiques et militaires imposés par le régime. Selon Tymkiw, qui invite ainsi à la prudence face aux exploitations politiques parfois très ambivalentes de la « participation », quelles que soient les connotations éminemment positives de la notion, il existerait bien des « formes actives, performées [performative forms] de la subjugation chez les spectateurs » (p. 9).
Du côté des créateurs de même, son étude appelle à se garder de trop homogénéiser les positions et de vouloir cerner une doctrine unifiée de la scénographie d’exposition nazie. L’une des grandes qualités du livre consiste justement à montrer combien, dans ses premières années tout au moins, la politique culturelle du IIIe Reich est demeurée un terrain de conflits et combien chaque exposition, loin de n’être que le reflet de prescriptions imposées d’en haut, restait le produit – tout autant que l’instrument – de positionnements spécifiques au sein d’un champ culturel encore très instable, dans lequel même de grandes figures du modernisme comme Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe ou Egon Eiermann cherchèrent à trouver leur place. Chacune des études de cas qui composent l’ouvrage est ainsi très précisément située dans un moment particulier de l’histoire du IIIe Reich, dans un contexte politique, institutionnel et discursif déterminé, ainsi que dans des parcours individuels. Plutôt que d’être appréhendée comme l’œuvre d’un créateur tout-puissant (approche qui domine indiscutablement les études sur les expositions d’avant-garde) ou à l’inverse comme l’émanation d’une instance étatique abstraite (ce qui marque en miroir les études sur les expositions nazies), la scénographie d’exposition, art foncièrement collectif, émerge ici comme le produit d’interactions, de tensions ou de compromis entre une multiplicité d’individus et d’intentions, ainsi que de définitions parfois discordantes de la culture national-socialiste. Bien des noms mentionnés en passant dans les recherches antérieures retrouvent alors la singularité de leur biographie, de leurs ambitions personnelles, de leurs positions esthétiques et idéologiques, et de leurs réseaux propres, à l’instar de Winfried Wendland, responsable des fameuses salles introductives de Die Kamera en 1933 et de leurs monumentales fresques photographiques, maintes fois discutées sans que l’on prenne la peine de s’intéresser à leur concepteur.
Si cette première grande foire passée sous le contrôle des nazis, centrée sur la photographie, a beaucoup contribué à donner à celle-ci une place majeure dans l’historiographie, l’enquête de Tymkiw s’applique justement à s’ouvrir au-delà d’elle. Pour les expositions photographiques elles-mêmes, il prend soin de rappeler comment les tirages y interagissaient souvent avec d’autres éléments, d’autres médias, tels les films et les machines au travail dans Gebt mir vier Jahre Zeit (Donnez-moi quatre ans) en 1937, articulés en une véritable dramaturgie d’animation progressive des images – et des visiteurs – dans l’enchaînement des salles. Mais il s’intéresse tout autant aux foires industrielles, aux expositions « culturelles » ou pseudo-scientifiques, ou encore à la funeste tradition des Schandausstellungen, ces expositions d’infamie destinées à discréditer ce qu’elles exhibaient – de Entartete Kunst (L’Art dégénéré) en 1937 aux grandes machines antisémites ou antibolchéviques encore organisées en plein cœur de la guerre.
Il révèle surtout l’importance d’une catégorie d’expositions peu considérée jusqu’à lui, les Fabrikausstellungen, un programme d’« expositions en usine », produites en série afin de diffuser gravures, œuvres d’art amateur ou objets d’arts appliqués dans les fabriques du pays. Tout un chapitre est consacré à ce passage vers la production de masse des expositions – plusieurs milliers seront organisées sur près d’une décennie –, cela paradoxalement afin de réintroduire au cœur de l’appareil industriel du IIIe Reich un illusoire imaginaire de l’artisanat et du travail manuel individualisé auprès d’ouvriers de plus en plus soumis aux diktats de la productivité mécanisée. L’analyse serrée de ces expositions dans leur évolution sur un temps long montre une nouvelle fois combien, loin de refléter une doctrine stable de l’exposition et de l’art officiels, un tel programme a pu être travaillé par de fortes dissensions esthétiques et idéologiques, des luttes de pouvoir et d’incessants repositionnements dont les expositions furent à la fois l’expression et l’instrument.
Tymkiw montre ainsi la diversité des formes prises par la politique d’exposition sous le national-socialisme, qui ne s’est aucunement résumée au retour à la monumentalité et aux médias traditionnels, mais s’est déployée à travers des espaces, des acteurs, des publics et des conceptions du spectateur très variés. Plus que les grands gestes néo-classiques et le gigantisme de certains pavillons comme celui de Paris en 1937, c’est bien cette plasticité qui conféra à la scénographie d’exposition son importance majeure pour le régime et que Tymkiw restitue en croisant aussi bien les cas d’étude que les sources convoquées pour les examiner. La richesse même des analyses qu’il réussit à tirer d’un unique aménagement mural, d’un seul présentoir ou d’une seule salle au sein d’expositions souvent beaucoup plus vastes laisse entrevoir la profusion d’objets potentiellement signifiants encore à prendre en compte, mais aussi le défi auquel se confronte ce domaine de recherche. Face à un art prolifique par nature – chaque grande foire ou exposition peut engager des centaines de collaborateurs, autant de stands et de présentoirs singuliers, marqués chacun par une confrontation d’intentions distinctes –, on perçoit l’éventail presque illimité des histoires possibles dès lors que l’on abandonne, avec raison, l’idée d’une doctrine unitaire autant que le primat des grands noms. Reconnaître la nature collective et la complexité génétique de cet art de l’exposition, c’est dès lors aussi accepter la compréhension nécessairement fragmentaire que l’on peut en avoir, quels que soient les efforts déployés pour en restituer la densité. Cela revient également à situer les « exhibition studies » entre une très grande ambition et une modestie qui lui est proportionnelle. L’ambition, c’est celle de mettre au jour le pouvoir de persuasion de dispositifs visuels éphémères, collectifs et volontiers anonymes d’autant plus négligés qu’ils ne se réduisent pas à des « images », encore moins à des « œuvres », et qu’ils demeurent souvent peu théorisés par leurs multiples créateurs. La modestie qui en est le corollaire, c’est celle d’une position qui, face aux intrications complexes que ces dispositifs engagent entre l’histoire et le visuel, reconnaît la plasticité fondamentale de l’écriture de l’histoire, dans les deux sens de l’expression, qu’elle renvoie à celles et ceux qui en furent, à un degré ou à un autre, responsables, ou à celles et ceux qui s’attachent aujourd’hui à l’éclairer. Nazi Exhibition Design and Modernism constitue un exemple remarquable de la fertilité de ce projet.
Référence : Olivier Lugon, « Michael Tymkiw, Nazi Exhibition Design and Modernism, 2018 », Transbordeur. Photographie histoire société, no 4, 2020, pp. 192-193.