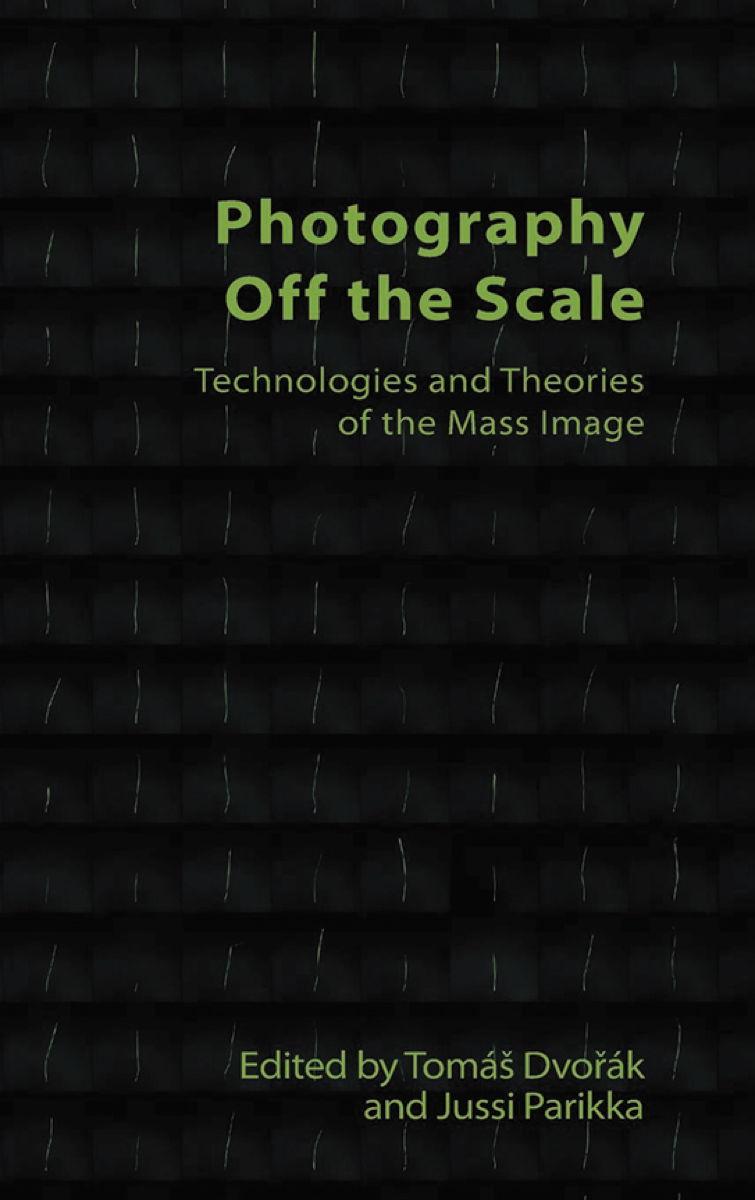
« Qu’est-ce que l’archéologie des média ? » demandait Jussi Parikka en 2012 dans le titre de son ouvrage-clef sur la discipline1. Ses pages exploraient en effet la dynamique des anciens et nouveaux médias, déployant le temps long de l’histoire des techniques, de ses survivances et des méthodes qui permettent d’entrevoir, à travers le système contemporain des objets, les « morts vivants » de la culture médiatique, les dispositifs oubliés qui servent de soubassement à notre vie quotidienne. Après avoir arpenté le temps de l’image et de la technique, c’est l’espace qui est convoqué par le chercheur, aidé de Tomáš Dvořák, dans Photography Off the Scale, sous-titré «Technologies et théories de l’image-masse ».
Cette sélection d’essais aborde la question de l’échelle des images et les implications épistémologiques, esthétiques et politiques de l’évolution de leur manière d’occuper l’espace. La photographie, cette représentation sans échelle spécifique, de plus en plus plastique et conversationnelle, est au cœur du propos qui prend aussi à bras le corps la question de la circulation des images, alors que des centaines de millions d’entre elles sont diffusées chaque jour sur Internet et les réseaux sociaux, et que cette déferlante s’accompagne paradoxalement de promesses de visibilité et de transparence totales, accueillies avec joie par les uns et inquiétude par les autres.
La roborative introduction pose les bases d’une sortie méthodologique de la sidération : cette abondance d’objets, et les sentiments qui l’accompagnent, ont une histoire. Avant le XIXe siècle, l’expérience de la surcharge d’informations était limitée à une élite savante qui la prenait en charge notamment par les bibliothèques, mais cette situation fut bouleversée par la production industrielle de textes et d’images qui ont depuis inondé la majeure partie de la population occidentale. Considérant que cet excès porte aujourd’hui avec lui des associations négatives comme le gaspillage et l’accumulation pathologique, les auteurs se refusent à déconnecter les questions d’échelles des enjeux de société.
Réfléchir sur l’échelle des images revient alors moins à se préoccuper d’objets grands ou petits, nombreux ou moins nombreux, qu’à mettre en perspective les dynamiques de qualification, de positionnement et de valorisation qui font partie intégrante des pratiques matérielles et des discours sur la quantité et la mesure. Ainsi le volume s’attelle à deux thématiques : d’une part, la manière dont les cultures médiatiques et techniques de la photographie sont médiatisées par des discours sur l’échelle et la quantité, et d’autre part, la façon dont ces discours incluent des interrogations sur la politique, la subjectivité, le genre et les pratiques technologiques qui convertissent le simple propos esthétique en dialogue.
À cette double préoccupation répond un plan à triple entrée : la première partie de l’ouvrage, intitulée « Échelle, mesure, expérience », lie l’épistémologie et la rhétorique de la mesure avec des réalités incarnées allant des images de l’anthropocène à celles produites par des femmes et hommes politiques. La seconde partie titrée « Méta-images et remédiations » reprend le concept de méta-image défini par W.J.T. Mitchell pour articuler différentes pratiques esthétiques et reconsidérer la distinction entre analogique et numérique. La troisième partie enfin, « Modèles, scans et I. A.», interroge les transformations de la photographie dans le contexte des images opératoires, de l’intelligence artificielle et des techniques d’automatisation des visions.
Donnant la parole à quatorze auteurs, le livre peut susciter chez le lecteur, comme c’est parfois le cas avec les ouvrages collectifs, un sentiment d’éparpillement. Cette impression est cependant compensée par une densité et une érudition rare : au fil des chapitres, c’est un panorama fortifiant de la critique idéologique contemporaine sur l’image photographique qui se déploie, rappelant les travaux fondateurs de Walter Benjamin ou Aby Warburg et tissant sa réflexion avec celle de Vilém Flusser, Allan Sekula, Jean-Luc Nancy, Hito Steyerl ou encore Susan Sontag. La première partie du volume s’ouvre sur un texte de Sean Cubitt, « Image-masse, image de l’anthropocène, communs des images », qui pose le paradoxe suivant : alors que les images « font sens » pour ceux qui les prennent, les regardent ou les téléchargent, elles sont au contraire « insignifiantes » dans les bases de données, ne constituant que des fichiers ayant perdu leur singularité. Ainsi se compose l’« image-masse », le mur d’image des réseaux, qui, en cherchant à se poser en représentation totalisante du monde, finit par créer un environnement qui exclut le monde.
L’ouvrage dans son ensemble incite donc à penser l’univers des images à partir d’une des idées-forces de Marx sur le capital : au stade de l’économie, le travailleur vivant produit du « travail mort » (le capital chez Marx, ici les images) qui acquiert une existence autonome que le producteur ne maîtrise plus et qui le dépossède de lui-même, de son temps et de sa capacité d’agir. Les textes d’Oliver Wendell Holmes et Allan Sekula sur la proximité entre monnaie et photographie sont ainsi discutés à nouveaux frais, permettant à Tomáš Dvořák de repenser le processus de « devenir image » du monde. Andrew Fisher renouvelle le débat sur l’aliénation et la photographie dans un contexte plus contemporain, étudiant le paradoxe des images qui énoncent notre présence et notre identité, mais aussi notre isolement et notre incapacité à échanger. Michelle Henning signe le texte le plus original de cette partie, interrogeant un autre pan de l’œuvre de Sekula, la critique de la photographie comme « langage universel », traçant un parallèle avec les emojis contemporains et la statistique en images développée par Otto Neurath dans l’entre-deux-guerres.
Les deuxième et troisième parties quittent le terrain de la critique idéologique pour s’ouvrir à des enquêtes salutaires sur la production et la circulation contemporaine des représentations dans des milieux techniques variés. Le lecteur découvre ainsi comment les méta-images et remédiations travaillent elles aussi l’image-masse, comme le montre Annebella Pollen dans son propos sur le réemploi de diapositives dans l’art contemporain, et Michal Šimůnek à travers l’analyse de l’ambition (érigée en mouvement culturel) de la marque Lomography. L’entreprise se propose en effet depuis 1994 d’agir comme un mouvement de résistance « analogique » face à la culture visuelle numérique dominante. Or, malgré la construction d’appareils imparfaits produisant des clichés imparfaits, les millions d’images diffusées sur le site de partage mis en place par Lomography, répétant à l’infini les mêmes imperfections, reconduisent les dynamiques de l’image-masse. Elles ne peuvent donc être considérées comme de véritables « images ratées » qui ne répondraient pas aux attentes généralement acceptées et socialement déterminées de ce qu’est une photographie.
Ouvrant la troisième partie, Jussi Parikka examine quant à lui les représentations créées à l’aide de capteurs. Depuis la découverte au début du XIXe siècle de l’infrarouge et de l’ultraviolet, jusqu’à l’utilisation actuelle du lidar pour la navigation des véhicules autonomes ou même du Wi-Fi pour détecter les postures et mouvements, ces formes de photographie non humaine cartographient continuellement les espaces. Le texte s’intéresse ainsi aux échelles multiples des arrangements infrastructurels qui construisent la ville comme une écologie de la lumière et de la détection. Celle-ci est décrite comme la cible privilégiée de nouvelles pratiques «post-lenticulaires», interrogées notamment à travers les œuvres de ScanLAB et Liam Young. Les images émergeant depuis le spectre non visible de l’impulsion et de la lumière révèlent ici comment des photographies peuvent prendre leur sens en dehors du champ de la vision humaine.
Joanna Zylinska clôt la troisième partie par la mise en dialogue de la théorie et de la pratique, à partir de ses propres expériences de création. Son interrogation concerne les relations que peuvent entretenir l’intelligence artificielle et la création d’images mécaniques : en prenant acte du caractère de «boîte noire» des appareils de prise de vue actuels, qui enferment de manière opaque une technologie complexe, l’auteure sonde le travail numérique non vu et non su des usagers. Ainsi est mis en perspective le concept de « photographie non humaine » afin d’étudier non seulement la manière dont les hommes sont vus par des machines ou la façon dont des machines voient des choses en dehors du spectre humain, mais aussi le fait que des humains agissent comme des appareils de vision. L’article invite de la sorte à voir sous un jour nouveau la portée de l’acte photographique, sa dimension créative et sa signification.
Assumant jusqu’au bout sa forme conversationnelle, avec ce que cela comporte de fulgurances mais aussi d’errances, le livre se termine sur un échange épistolaire entre l’artiste espagnol Joan Fontcuberta et le théoricien australien Geoffrey Batchen. Passant du hooliganisme intellectuel à la théorie de la décroissance pour mieux penser la désacralisation des images et le destin du photographe professionnel, les deux hommes prolongent, sans donner de conclusions péremptoires, le propos de l’ouvrage, la réflexion sur l’image-masse et sa dimension multiscalaire. Si le sujet ne semble pas épuisé, les enquêtes menées donnent déjà une direction forte au débat en révélant comment les stratégies techniques contemporaines occultent les conditions matérielles de production des images et leurs acteurs réels. Ces investigations permettent aussi d’entrevoir la manière dont l’image photographique pourrait se distinguer du « travail mort » et de ses dynamiques aliénantes.
Référence : Clément Paradis, « Tomáš Dvořák et Jussi Parikka (dir.), Photography Off the Scale. Technologies and Theories of the Mass Image, 2021 », Transbordeur. Photographie histoire société, no 6, 2022, pp. 170-171.