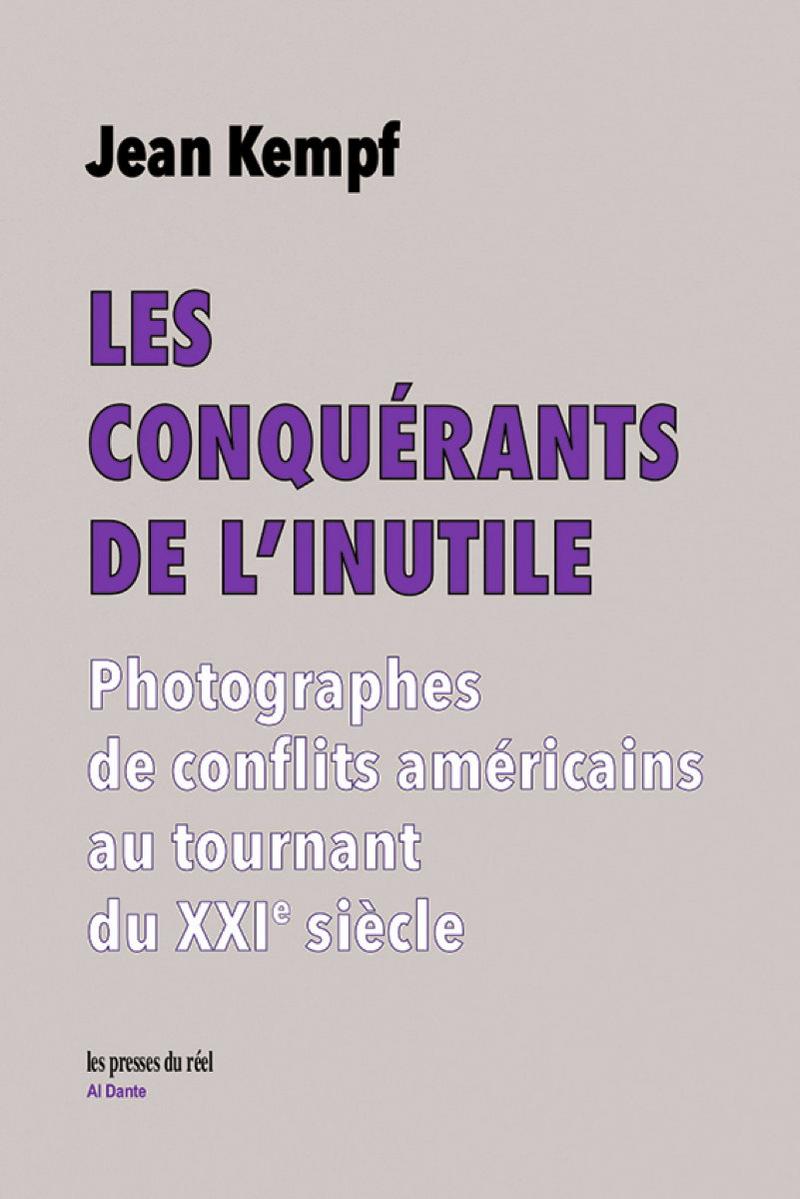
Ils s’y sont immédiatement rendus. James Nachtwey, les frères David et Peter Turnley, Éric Bouvet, Luc Delahaye, Patrick Chauvel, Ron Haviv, Laurent Van Der Stockt, tous ont pris la direction de l’Ukraine dans la foulée de l’invasion russe. Rompue aux théâtres d’opération risqués depuis l’éclatement de l’ex-Yougoslavie, cette aristocratie du photojournalisme de guerre a ainsi repris du service, aux portes de l’Europe. Mais pas dans les conditions économiques et logistiques de naguère, c’est-à-dire sans l’assurance d’être publiée, donc sans garantie de revenu, parfois même sans couverture sociale, et aux côtés d’un nouveau prolétariat photographique composé de photographes mal, voire pas du tout formés, mais prêts à prendre beaucoup de risques pour se faire un nom. En cette époque d’ubérisation du secteur de l’information visuelle, pourquoi vétérans et novices partent-ils sur les lignes de front ? Le contexte actuel paraît confirmer les questionnements de cet ouvrage paru justement au moment où ces photographes répondaient à l’appel des événements.
Présenté comme une « enquête détaillée sur les pratiques concrètes des photographes de conflit » (4e de couverture) prenant comme marqueur temporel initial la guerre des Balkans, cet ouvrage a pour ambition d’exposer les déterminations, les spécificités, les mythes et les défis éthiques, économiques, logistiques et psychologiques inhérents au métier de photojournaliste. Pour cela, l’auteur a recours à une méthodologie inspirée de la sociologie des professions et fait reposer ses arguments sur la foi de la parole des principaux acteurs du secteur. L’approche préconisée est interactionniste en ce qu’elle privilégie « l’auto-définition liées [sic] aux interactions entre acteurs » (p. 15), sur le modèle du travail de Denis Ruellan, Le Journalisme ou le professionnalisme du flou (2007). « [Ma] documentation, précise Kempf, est essentiellement constituée de la parole recueillie des photographes de conflit américains de la génération ‹ post-balkanique › » (p. 17). Le matériau d’analyse est ainsi tiré d’entretiens conduits par des tiers, les interviews menées par l’auteur n’apportant, de son propre aveu, rien de véritablement neuf, tant les premières réponses obtenues recoupent celles récoltées par d’autres chercheurs. Kempf en attribue la cause au fait que « le discours des photographes sur eux-mêmes [est] intrinsèquement structuré par des schèmes tellement puissants » (p. 18). C’est donc sur la base de ces récits institués que sont construits les six temps d’un parcours mettant en exergue les expériences des photographes, et non leur réalisation. Il n’est en effet pas question d’images ou de fabrique éditoriale de l’information visuelle dans cet ouvrage, mais bien d’éthos du producteur.
Le premier chapitre, intitulé « Partir », interroge ainsi les motivations de celles et ceux que rien n’oblige à se rendre sur des conflits armés : croyance en la fonction sociale et éthique de la photographie de presse, importance de témoigner des conditions de vie des populations civiles affectées par les guerres, nécessité morale de donner une voix à celles et ceux qui en sont privés ou volonté de peser dans le débat public au moyen des images. Ces nobles intentions humanistes sont toujours vivaces, car sanctuarisées par des récits mythiques, souvent autobiographiques, entretenus par des modèles tutélaires : Robert Capa, Philip Jones Griffith, Don McCullin, David Douglas Duncan, entre autres. Moins avouables, la quête de notoriété, l’attrait du danger et la soif d’adrénaline, observe l’auteur, figureraient bien davantage parmi les sources de motivation qui animeraient les plus jeunes générations de photographes, qu’une absence de formation et d’expérience mettrait plus particulièrement en danger. Désengagement des responsabilités des commanditaires, absence de cadre normatif et professionnel solide, essor d’un auto-entrepreneuriat composé de pigistes mal préparés aux réalités du terrain sont au nombre des causes et symptômes d’une précarisation du secteur que l’auteur expose dans un portrait des mutations socio-économiques que connaît la profession depuis les années 1990 principalement. Dans le second chapitre – « Vivre sur le terrain » –, il consacre un développement spécifique aux femmes photojournalistes, en s’appuyant abondamment sur la parole de la photographe américaine Lynsey Addario, et signale les risques particuliers auxquels celles-ci s’exposent sur les théâtres d’opération (violences à caractère sexuel), le sexisme ordinaire auquel elles font souvent face (de la part de leurs collègues masculins, notamment), mais aussi les situations où le genre peut s’avérer un sésame (on évoque les sociétés où l’espace féminin est fermé aux hommes). Après les motivations et les récits de terrain, ce sont les conditions contemporaines de production du photojournalisme, la fragilisation économique de ses acteurs, l’individualisation des responsabilités et les mutations technologiques liées au numérique qui retiennent l’attention de l’auteur dans le chapitre « Produire ». Preuve de cette évolution socioéconomique, la pression croissante exercée sur les photographes à qui il est demandé de produire de plus en plus d’images sur un même sujet. La durée de vie publique des photographies étant devenue très courte sur les plateformes (souvent moins d’une heure), les rédactions requièrent de la part des pigistes qu’ils aient la capacité de les alimenter en continu. Le désir de réaliser une image iconique est peut-être encore vivace chez ces derniers, mais le fait est qu’il est attendu principalement d’eux la production en masse des images rapidement périssables. Plus bref, le chapitre 4, dénommé « Revenir », passe en revue les troubles rencontrés par les photographes de retour de mission. Le contraste entre « l’intensité de la vie sur le terrain face à celle de ‹ l’arrière › beaucoup plus routinière » (p. 123), de même que la distance « entre la misère et la mort d’un côté et l’abondance de l’autre », sont, rappelle-t-on, causes de troubles anxieux (PTSD/ TSPT), que la mise en récit des traumas, de même que la constitution de communautés de soutien permettraient toutefois d’atténuer. Qualifiant de critiques de spectateurs (c’est l’auteur qui souligne) « le procès de la photographie comme auxiliaire de la violence et de la guerre » (p. 151) instruit par Susan Sontag, Susan Linfield, Barbie Zelizer ou encore Robert Hariman et John Lucaites, Jean Kempf souligne en ces termes dans le cinquième chapitre, « Communiquer », la singularité des enjeux éthiques du « photographe témoin » : « D’une part, se pose à lui/elle de savoir comment se comporter dans le même espace physique face à la souffrance d’autrui et d’autre part comment rester fidèle à des valeurs qui pré-existent à la situation et la dépassent, en d’autres termes comment la théorie survit-elle à la réalité » (p. 152). C’est ce poids du réel qui leste psychiquement les photographes. C’est aussi lui qui confère une gravité aux images, dont l’efficacité politique demeure toutefois incertaine, comme l’auteur s’emploie à le rappeler, dans le dernier chapitre « S’interroger », par la formulation de ces deux questions à la tonalité désenchantée : « À quoi sert la photographie de guerre ? » et « La photographie (de guerre) a-t-elle (encore) un public ? »
Depuis les années 1990, les études consacrées au photojournalisme ont ébranlé les mythes, les croyances et les légendes forgés par ses figures tutélaires et substitué aux récits de ces derniers de nouveaux discours fondés sur l’examen patient des rouages de la fabrique de l’information visuelle, pour reprendre le titre d’un ouvrage porté par cette exigence1. Traquer les écarts entre les intentions déclarées et les usages avérés fut le mot d’ordre d’une génération de chercheurs prenant ses distances avec les écrits parfois complaisants publiés par les acteurs mêmes du photojournalisme et remettant en cause l’autorité interprétative des témoignages et des attestations personnelles. D’où la première impression, si l’on rapporte l’ouvrage de Jean Kempf à cette révision historiographique du photojournalisme, d’en revenir à des habitus méthodologiques aujourd’hui déclassés par les études photographiques. En faisant de la parole des photographes le seul matériau à l’étude, l’auteur pourra surprendre le lecteur, la lectrice voulant absolument affranchir cette historiographie de la tutelle des mots des praticiens. Mais il y aurait peut-être une autre façon d’envisager cet ouvrage, afin d’y voir autre chose qu’une actualisation d’une publication qui fut en son temps fort bien accueillie, et dont la périodisation s’arrête précisément là où commence celle du livre de Kempf : Profession Photoreporter : vingt ans d’images d’actualité2. Car tout comme celui faisant l’objet du présent compte rendu, l’ouvrage de Michel Guerrin prenait le pouls des aspirations, contraintes et idéaux des photojournalistes, les images en plus. Or, l’ouvrage de Kempf, nous l’avons dit, ambitionne plutôt de situer l’enquête sur un plan sociétal, organisationnel et expérientiel du photojournalisme. Après avoir étudié la matérialité des images, les écosystèmes de l’édition, les archives et les formes publiques de monstration des images de presse, peut-être le moment est-il effectivement venu de replonger dans les méandres des intentions, des témoignages et des retours d’expérience ? Nul doute, cet ouvrage nous y convie. Il aurait cependant importé, s’il est un avenir à cette approche, de mieux la faire valoir, par une prise de position claire en sa faveur, adossée aux appareillages de la sociologie d’enquête, et de la situer dans l’histoire récente de sa relégation par les études photographiques.
Référence : Vincent Lavoie, « Jean Kempf, Les Conquérants de l’inutile. Photographes de conflits américains au tournant du XXIe siècle, 2022 », Transbordeur. Photographie histoire société, no 7, 2023, pp. 196-197.