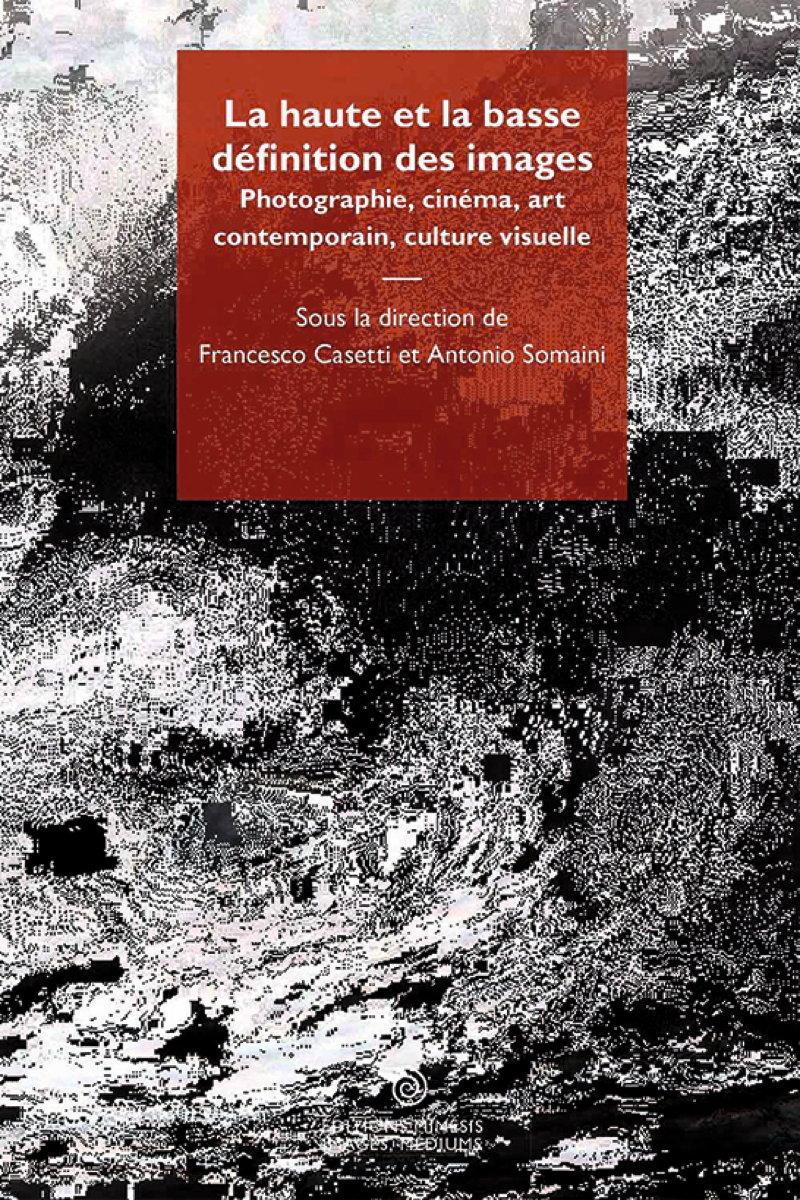
En 2009, l’artiste allemande Hito Steyerl consacrait un essai au problème de la « définition » des images, une analyse critique des enjeux techniques, politiques et économiques de l’imagerie numérique. Steyerl y affirmait que dans la mesure où les images de basse résolution et de haute compression (ce qu’elle nommait les images « pauvres » ou « populaires ») circulent à travers Internet plus rapidement que les images en haute définition (par opposition, les images « riches »), celles-ci participent de l’émancipation des contenus visuels, notamment « militants et expérimentaux1 ». Près de quarante années plus tôt, Marshall McLuhan proposait quant à lui une véritable climatologie de la médiation en opposant les médias dits « chauds » (la photographie notamment), dont la haute définition permet de transmettre une grande quantité d’information, aux médias dits « froids », à basse définition (comme la télévision ou le téléphone), qui, au contraire, exigent un fort degré d’implication sensorielle du récepteur – et en ce sens, le degré de définition propre à chaque média détermine la nature du message. Dans un cas comme dans l’autre, le critère de la qualité des médias, notamment optiques et iconiques, est reconnu comme un objet d’étude et un sujet digne d’attention critique. Si ces textes figurent en bonne place dans nombre de syllabus anglo-saxons en études visuelles et étude des médias ces dernières années, la question de la définition soulevée par Steyerl et McLuhan a jusqu’alors fait l’objet d’une bibliographie pour le moins étique en langue française2. C’est précisément ce déficit que vient combler le récent ouvrage collectif dirigé par Francesco Casetti et Antonio Somaini publié aux Éditions Mimésis. Ce volume comprend en tout une vingtaine de textes rassemblant des contributions d’historiens et historiennes de l’art, du cinéma et de la photographie, mais aussi des essais d’artistes contemporains ainsi que deux entretiens avec les historiens du film Raymond Bellour et Roger Odin.
Le parallèle entre les considérations de Steyerl et celles de McLuhan permet d’emblée de saisir l’étendue du cadre chronologique et la pertinence du problème dont traite l’ouvrage. D’abord parce que les remarques de McLuhan, publiées dans les années 1960, montrent que la question de la définition précède largement l’avènement des images numériques. Dans l’introduction, Francesco Casetti et Antonio Somaini soulignent à juste titre la nécessité de traiter du sujet à travers le prisme rétrospectif de l’archéologie des médias, une démarche invitant à envisager aussi l’étude de la définition des images filmiques et photographiques. C’est là l’objet de la démonstration d’Antonio Somaini dans sa propre contribution, une éclairante archéologie du problème depuis les années 1920 jusqu’à nos jours, abordant des médias comme le film, la presse, la vidéo et l’infographie. Comme le démontre Somaini, le problème de la définition des images et sa généalogie recoupent en réalité autant la lignée de l’image « matricielle » ou « rastérisée » – une archéologie qui remonte aux métiers à tisser, à l’impression demi-teinte ou encore au balayage de la télévision cathodique – que la distinction entre l’image nette et floue, une thématique familière aux historiens de la photographie et du cinéma – sur laquelle revient par ailleurs Marie Rebecchi dans sa contribution au volume. À travers cette double filiation, le problème de la définition excède largement celui de la mesure du nombre ou de la densité des pixels des images numériques et devient un véritable objet pour les études visuelles, au sens le plus large et le plus interdisciplinaire du terme.
Ce volume fait aussi et surtout état des implications épistémologiques, économiques et politiques du problème de la définition des images. Si l’on retrouve tout particulièrement ce présupposé dans les contributions prenant pour point de départ des analyses filmiques (comme c’est le cas des essais de Peter Szendy, Filippo Fimiani ou Emmanuel Burdeau), l’idée captivante qu’un certain régime de vérité et de réalité, qu’un certain degré de confiance et d’affect envers les images accompagneraient chaque niveau de définition est en fait commune aux contributeurs. C’est ainsi que dans la continuité des récentes études de « formats » médiatiques3, André Habib analyse la pratique dite du « filmizing », c’est-à-dire la simulation en postproduction numérique du grain et de l’usure des supports filmiques, ou encore qu’Arild Fetveit offre dans son essai une esthétique des affects du « bruit » altérant la qualité des médias optiques. Outre la question du format, on trouvera aussi dans l’ouvrage des échos aux récentes études sur la circulation des images4, notamment dans les analyses des pratiques de diffusion de l’art vidéo et du cinéma expérimental qu’offrent Erika Balsom et Enrico Camporesi dans leurs essais respectifs.
La majorité des contributions s’accorde à décrire une même inflexion vers un récent surplus de qualité, un mouvement qui suivrait le rythme effréné du progrès et de l’obsolescence technologique. De fait, la survivance d’images « pauvres » dans l’univers ultracontemporain est l’une des problématiques centrales de l’ouvrage. À cet égard, certains contributeurs empruntent plus ou moins explicitement aux écrits de McLuhan et Steyerl l’idée que la basse définition serait l’apanage de l’avant-garde et de l’art expérimental – « le froid […], le primitif […], nous permet une participation en profondeur et une expression totale », comme l’écrivait McLuhan5. Toutefois, si le goût pour les images pauvres, comme le note assez justement Arild Fetveid dans son essai, est certainement une réponse conjoncturelle au sentiment de dématérialisation des médias numériques, on peut questionner la pertinence à long terme des approches critiques ayant tendance à systématiser l’idée que la basse définition serait une sorte de valeur refuge. Plus généralement et à considérer l’ensemble des essais, il semble que l’étude de la définition des images gagne à délaisser, ou à tout le moins à problématiser plutôt qu’à reconduire aveuglément, une certaine hiérarchie, autant matérielle que culturelle (high et/ou low), selon laquelle la valeur esthétique, critique ou politique d’une image serait inversement proportionnelle à son niveau de définition. La contribution de Francesco Casetti, une analyse « topologique » des liens entre la définition des images et l’environnement physique (le mediascape) dans lequel celles-ci sont diffusées, s’empare du problème central de l’ouvrage à des fins méthodologiques tout particulièrement astucieuses en contournant des questionnements sur la spécificité des médias, qui se confondent bien souvent avec des jugements de valeur culturels. En arrière-plan de son étude contextuelle de l’image, c’est en effet toute la problématique « situationnelle » par laquelle les études filmiques se sont interrogées sur la spécificité du dispositif et des lieux de diffusion du cinéma ces dernières décennies qui se trouve reformulée sous un jour nouveau – ce qui apparaît assez clairement à considérer en parallèle la contribution de Francesco Casetti et la transcription de son dialogue avec Raymond Bellour, reproduit en fin d’ouvrage.
Parmi les multiples approches méthodologiques employées par les contributeurs du volume, celles sensibles à la matérialité technique des images pourront sembler plus judicieuses que celles ayant pour objet de sonder le rapport entre les usages, les affects et la qualité des médias optiques, tout particulièrement lorsque la question de la définition porte sur l’univers numérique. Si le cours de l’évolution des technologies visuelles est certes ultrarapide, il semble en effet moins sujet à des fluctuations que celui des usages. On peut ainsi considérer que les pratiques intensives du piratage de film et les questions de définition que celles-ci soulèvent, décrites notamment dans la contribution de Frédéric Montvoisin, ne sont plus aussi répandues qu’elles ne l’étaient il y a une dizaine d’années dans les principaux pays occidentaux, en raison des législations et du développement des plateformes de streaming. Dans une même veine et toujours au sujet de l’univers digital, on pourrait aussi relever que l’usage des filtres imitant le grain photographique ne semble désormais plus une pratique à l’ordre du jour sur les réseaux sociaux.
À nouveau, la question de la définition des images est en fait des plus convaincantes et captivantes lorsqu’elle repose sur une analyse resserrée de la matérialité des médiations optiques. C’est le cas de la contribution d’Antonio Somaini, mais aussi de celle de Joseph Gaboury, par ailleurs auteur d’une récente et passionnante archéologie de l’infographie6. L’approche technomatérialiste de Gaboury permet en effet d’opposer aux distinctions entre images « pauvres » et « riches » le constat d’une précarité globale du visible au sein du capitalisme contemporain, une proposition formulée à l’aune d’une étude de l’impact social et environnemental des méthodes de production de l’imagerie digitale. En démontrant combien la délocalisation du travail de rendu des principales firmes d’imageries synthétiques reflète des dynamiques géographiques inégalitaires bien malheureusement trop familières, et en précisant l’impact sur l’environnement des pratiques d’image processing, Gaboury semble ainsi très justement relever le défi méthodologique passionnant de cet ouvrage qui présage, espérons-le, de l’émergence du champ propre des definition studies.
Référence : Pierre-Jacques Pernuit, « Francesco Casetti et Antonio Somaini (dir.), La haute et la basse définition des images. Photographie, cinéma, art contemporain, culture visuelle, 2021 », Transbordeur. Photographie histoire société, no 7, 2023, pp. 190-191.