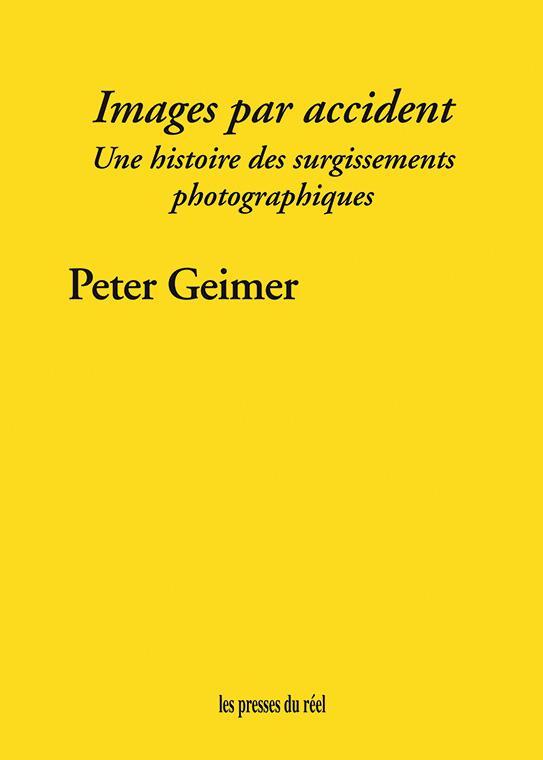
Faire l’histoire des symptômes, des accidents, des altérations, des perturbations, de l’instabilité des images et chercher les régimes de visibilité spécifiques qui en découlent ; voici, en somme, le projet énoncé d’Images par accident. Dans cet essai, paru en allemand en 2010 et dont la traduction française est désormais disponible aux presses du réel, Peter Geimer, professeur d’histoire de l’art à la Freie Universität Berlin, entreprend l’étude de ce qui constitue non pas simplement un corpus oublié par une histoire canonique de la photographie, mais un ensemble marginalisé par la définition classique du médium. Des rayogrammes des avant-gardes historiques aux premiers daguerréotypes altérés par le temps, en passant par les effluviographies ou le Saint-Suaire de Turin, l’auteur s’appuie sur des images qui ne sont ni inaltérables, ni fidèles, ni intentionnelles, et excèdent de ce fait les traditionnelles bornes épistémologiques et chronologiques de l’histoire de la photographie.
Peter Geimer entend montrer que ces surgissements photographiques ont une potentialité spécifique : celle de dévoiler le matériau, et de libérer ainsi le médium de son caractère transparent et de son lien indéfectible à l’objet qu’il représente tel que porté par l’approche sémiologique de Roland Barthes. Par l’intégration de ces images qui bousculent les frontières de la photographie, Geimer poursuit le travail de déconstruction historiographique de l’histoire linéaire du médium bâtie autour de l’idée de son invention. Si la date de 1839 comme année de départ de l’aventure photographique, avec Daguerre pour unique protagoniste, apparaît aujourd’hui comme un indéfendable poncif, cette construction historique s’est appuyée sur un certain nombre de critères qui lui permettaient de se justifier. Le fait de décréter que l’invention photographique avait eu lieu induisait d’exclure les formes passées et futures de surgissement d’images spontanées ou altérées par des procédés chimico-optiques, à l’instar de ces plaques de verre aux couches si craquelées et boursouflées qu’il est impossible de distinguer l’objet de la représentation et qui s’accumulent dans les archives. L’essai entend donc s’appuyer sur ces rebuts pour excaver les visibilités troubles qui en émergent et ainsi complexifier et élargir le champ de l’histoire de la photographie.
Dans le chapitre d’ouverture, c’est selon une perspective latourienne que Geimer se penche sur la préhistoire du médium, en se demandant : « De quoi l’histoire de la photographie est-elle l’histoire ? » En revenant sur les précédents historiques d’impressions d’images par le fruit du hasard et de matériaux sensibles qui ont fasciné tant formellement que scientifiquement et suscité de nombreux discours, il cherche à montrer l’absence de rupture que constitue ce qui a longtemps été considéré comme l’invention de la photographie. Dans cette histoire longue qu’il illustre d’exemples, le caractère arbitraire des critères de l’épistémologie du médium se révèle avec force. Sans en proposer de nouveaux, il démontre le peu d’intérêt d’une recherche portant sur la définition d’une essence de la photographie. Plutôt que la définition d’une pureté du médium, ce chapitre montre que la préhistoire de la photographie a pour spécificité son caractère accidentel et hasardeux. Cette spécificité, et c’est tout l’objet du second chapitre, ne disparaît pas une fois le médium entré dans sa phase historique. L’accident qui jusqu’alors semble, par ses vertus heuristiques, avoir mené à la photographie telle que définie lors de son invention, subsiste. Le changement résidait dans le fait que ces accidents semblaient désormais être des perturbations d’un procédé alors stabilisé. En s’appuyant sur la riche littérature que le XIXe siècle a produit en réaction à ces accidents ou ces « ennemis de la photographie », comme ils sont alors nommés, Peter Geimer démontre que sous cet apparent aspect péjoratif se cache une double potentialité. Tout d’abord, comme objet de connaissance : les altérations des photographies donnaient lieu à de riches débats qui encourageaient la recherche d’un savoir plus affiné sur les effets de la photographie et sur son fonctionnement. Ensuite, ces erreurs produisaient un registre formel qui, sans être explicitement loué pour ses qualités esthétiques, était décrit avec une précision remarquable. Dans les deux cas, le raté photographique enjoignait les spectateurs à considérer le matériau photographique lui-même et non plus sa transparente représentation.
Cette mise au jour des erreurs et altérations de la photographie et de ses renouvellements à chaque nouveauté technique posait la question sous-jacente de la véracité de la photographie. La recherche de l’origine des perturbations était au cœur des débats. L’enjeu était de savoir si la forme apparue sur la surface sensible était naturelle ou un artefact lié au procédé. C’est autour de cette dichotomie que se concentrent les deux chapitres suivants consacrés à deux cas d’étude. Le premier porte sur Jules Bernard Luys et les photographies fluidiques, le second sur le Saint-Suaire de Turin. Richement documentées, ces parties permettent de comprendre les débats qui entourent les perturbations photographiques. Tiraillées entre l’artefact et le naturel, les discussions ont oscillé entre la croyance dans le phénomène naturel décrit, que ce soit l’inscription du fluide vital ou l’empreinte à distance du visage du Christ, et son invalidation par l’explication optico-chimique de l’artefact. Dans tous les cas, la vigueur et la minutie des discours qui entourent ces images démontrent que la photographie dit toujours quelque chose du monde et se teinte d’une valeur épistémique : soit elle donne à voir une chose jusqu’ici invisible, soit elle permet d’expliquer avec plus de précision son fonctionnement. Cependant, pour Peter Geimer, il reste de ces discussions une « indécision constitutive » qui caractérise la visualisation photographique.
Ces cas illustrent aussi l’usage de la photographie dans les pratiques scientifiques qui, à la fin du XIXe siècle, cherchent à rendre l’invisible photographiquement visible. Cette quête, l’auteur nous y mène dans les chapitres finaux. La notion d’indécision se retrouve lors du cinquième chapitre nommé «Visible/Invisible. Critique d’une dichotomie ». Après avoir cherché à définir ce que peut être une photographie de l’invisible en traversant les diverses acceptions que le champ de la photographie scientifique lui a données, il s’interroge sur ce que cette notion dit des régimes de visibilité. Si l’imagerie de l’invisible – telle que traditionnellement entendue par l’histoire de la photographie – peut s’apparenter à la production d’une visibilité nouvelle, elle impose – par son manque de référent dans le champ du visible – une fonction exploratoire du médium. Plus encore, elle fait émerger des formes jusqu’alors inédites et énigmatiques qui imposent d’appréhender le monde d’un regard naïf. Cette étrangeté du quotidien qui advient par la photographie scientifique puis semble reprise par les avant-gardes artistiques, Peter Geimer entend l’approcher tant par les textes que par les images, relativisant alors la séparation stricte entre l’artistique et le scientifique. Sans nier les différences de motivation des deux pratiques, il justifie leur parenté par la volonté de distanciation photographique des choses, et par la promotion d’une visibilité nouvelle, participant, à son sens, d’un « inconscient optique ».
Si l’appareil photographique permet de rendre visible ce que l’œil ne voit pas, alors c’est qu’il a des capacités supérieures à l’organe humain. Geimer propose, dans son dernier chapitre, une archéologie des discours qui ont comparé l’œil humain et l’œil artificiel de la photographie, et dont le rôle épistémique est de conclure à la déficience de l’organe physiologique. Par son incapacité à supporter la lumière au magnésium et par son temps de réaction particulièrement long que les chronophotographies d’Albert Londe ont mis en image, l’œil semble, encore une fois, défaillant face à la photographie. Cette analogie, bien qu’incohérente, perdure pour des raisons de rhétorique : elle permet de justifier la capacité de la photographie à montrer l’invisible et à augmenter la visibilité. Un dernier cas d’étude portant sur les photographies de gouttes du physicien anglais Arthur Worthington met habilement en exergue les effets de cet usage exploratoire de la photographie de l’invisible sur la recherche scientifique, tant dans les pratiques de visualisation que dans les procédés expérimentaux du début du XXe siècle.
Autant par la richesse de ses analyses que par la rigueur dans le traitement de ses cas d’étude, Peter Geimer convainc de la nécessité de son propos qui poursuit le travail déjà amorcé par l’étude de l’erreur photographique (comme dans Fautographie de Clément Chéroux en 2003). Plaidoyer pour repenser notre approche de la photographie, non plus à travers le paradigme de son réalisme supposé et de ses dichotomies « subjectif/ objectif, construit/réaliste, artificiel/ naturel », mais au prisme d’un surgissement sur l’image qui échappe au contrôle absolu de ses producteurs, l’auteur parvient à complexifier les outils d’analyse de la photographie sans chercher rhétoriquement à les faire entrer dans un nouveau dogme, dans une nouvelle méthodologie strictement définie. Prenant en charge un corpus souvent réduit à un statut d’anecdote racontant les essais ratés du médium ou la croyance naïve en la photographie, Peter Geimer réussit par la puissance de son argumentation à lui donner une force épistémique qui nous encourage à abandonner les axiomes traditionnels de l’histoire de la photographie. Un seul regret demeure quant à la place de l’iconographie. Si elle permet d’illustrer les exemples du propos et d’ainsi rendre la lecture particulièrement aisée, elle ne trouve pas son autonomie, en tant que seconde forme d’argumentation, par la mise en page ou la confrontation visuelle.
Référence : Alice Aigrain, « Peter Geimer, Images par accident. Une histoire des surgissements photographiques, 2018 », Transbordeur. Photographie histoire société, no 4, 2020, pp. 182-183.