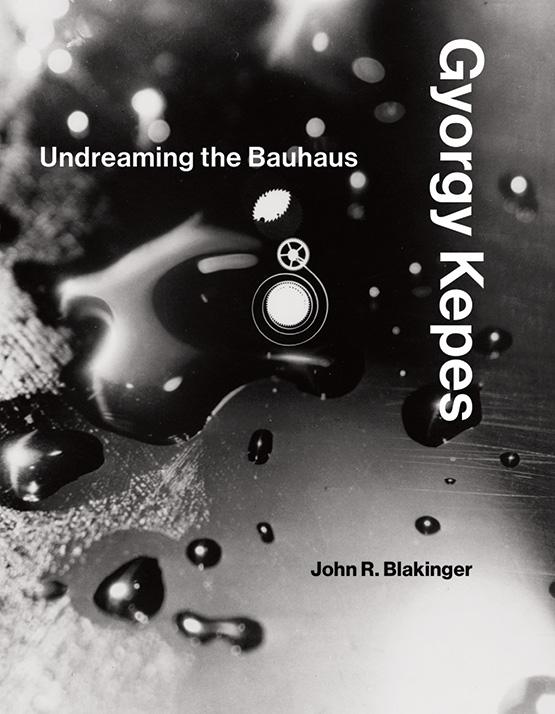
John R. Blakinger, György Kepes. Undreaming the Bauhaus, 2019 & Jean-Marie Bolay, György Kepes. Du langage visuel à l’art environnemental, 2018
Mario Lüscher
À l’occasion du centième anniversaire de la création du Bauhaus, de nombreux travaux se sont penchés sur ce qu’avait été cette école du temps de son existence, mais bien peu se sont interrogés sur ce qu’est devenu ce projet central de la modernité après coup. Non pas tant pour reconstruire artificiellement des continuités que pour décrire la complexité des collisions, des faisceaux d’interactions ou des affinités électives provoquées par la diffusion de l’esprit du Bauhaus à travers la multitude de ses membres dispersés aux quatre coins du monde. L’esprit de l’école revenant hanter jusqu’à sa propre histoire pose pourtant une question persistante dans le contexte de la réflexion sur l’héritage de la modernité et de son historicisation continue.
Dans ce contexte, la vie et l’œuvre du photographe, théoricien, enseignant et scénographe d’exposition György Kepes (1906-2001) font figure de modèles. Ayant grandi en Hongrie, Kepes suit une formation d’artiste à Budapest. Là, la répression de la République des conseils hongroise participe à son engagement politique et le rapprochement avec le cercle de Lajos Kassak le met en contact avec l’avant-garde européenne. Kepes devient bientôt l’assistant de László Moholy-Nagy, qui dirige un bureau de publicité à Berlin après avoir quitté le Bauhaus en 1928. Il le suit à Londres en 1935, puis au New Bauhaus de Chicago en 1937. Pendant la guerre, il œuvre comme spécialiste du camouflage pour l’armée américaine. À partir de 1947, il est chargé de cours à la School of Architecture and Planning du MIT, où il fonde en 1968 le Center for Advanced Visual Studies (CAVS), qu’il dirigera jusqu’à sa retraite en 1974. Kepes s’éteint en 2001 à l’âge de 95 ans à Cambridge, dans le Massachusetts.
Les deux monographies de John R. Blakinger et de Jean-Marie Bolay enrichissent la littérature sur György Kepes de manière significative, ce dont on peut d’autant plus se réjouir pour le champ francophone. Cette multiplication des points de vue est particulièrement bienvenue dans le cas de Kepes, personnage aux facettes multiples, qui articula sur une période très longue un nombre important de thèmes, de méthodes et de topographies. Son travail éditorial, mené sur plusieurs décennies, constitue probablement l’activité qui a laissé l’héritage le plus visible : The Language of Vision, son premier livre, en 1944, issu de ses réflexions sur la Gestalttheorie, trouvera ainsi un écho durable – chez les artistes surtout, dans une moindre mesure chez les historiens d’art. Blakinger y localise « une forme d’art propre à Kepes : l’essai visuel », là où son œuvre commercial, graphique ou photographique ne sut jamais complètement se débarrasser de l’impression d’un certain manque d’originalité. La forme de l’essai visuel marque notamment de son empreinte la colossale entreprise éditoriale Vision+ Value (1965-1972), collection de livres qui réunira une myriade de scientifiques, d’artistes et de penseurs, mais n’aura finalement que des effets limités sur l’interdisciplinarité. L’absence d’écho de cette « science unifiée » déployée de manière ostentatoire par la réunion de ces livres semblerait même plutôt confirmer la thèse des Deux Cultures de C.P. Snow. À l’inverse, les expositions de Kepes, The New Landscape in Art and Science (1951), Light as a Creative Medium (1965) ou Nightscape of the City, présentée à la 14e Triennale de Milan en 1968, eurent un écho considérable. Son opus magnum théorique, le LightBook – Blakinger ose la comparaison avec le Le Livre des passages de Benjamin – n’a, en revanche, jamais été publié. Quant au Center for Advanced Visual Studies, concrétisation d’une vision longtemps poursuivie par Sigfried Giedion1, sa création a coïncidé avec les manifestations de 1968 contre la guerre du Vietnam. Au moment de sa fondation, la CAVS se retrouvait donc déjà en porte-à-faux avec l’attitude anti-institutionnelle de la communauté artistique contemporaine, que Kepes avait pourtant voulu contribuer à former avec la mise en place de son institut.
Mais c’est surtout par le charme créatif de l’infatigable homme de réseaux qu’il était et par son rôle de propagateur des notions d’« interthinking » et d’« interseeing » que Kepes devint la figure du grand médiateur, presque médium lui-même, comme si, pour paraphraser son collègue Marshall McLuhan, il se mettait à incorporer en sa personne son propre message. « L’artiste est maintenant porté […] à quitter sa tour d’ivoire pour la tour de contrôle de la société2 » écrivait encore McLuhan. L’artiste ayant depuis longtemps abandonné à la technologie la position d’avantgarde qu’il revendiquait autrefois pour lui-même, sa présence dans la tour de contrôle devint effectivement un impératif. La métaphore technoarchitecturale de McLuhan doit se lire à la lumière du débat sur le rôle joué par l’artiste dans le cadre de son rattachement institutionnel – dans le cas de Kepes, une université d’élite américaine en pleine guerre froide, où il est amené, comme le souligne surtout Blakinger, à participer à un complexe militaro-industriel tout autant qu’universitaire. Ce contexte a déterminé de façon décisive les études antérieures, principalement américaines, sur la vie et l’œuvre de Kepes, avec notamment, et de la manière sans doute la plus radicale, l’enquête décisive de Reinhold Martin, The Organizational Complex. Architecture, Media and Corporate Space (Cambridge, Mass., 2003). Bien que les livres de Kepes aient été traduits dans de nombreuses langues, sa réception hors des États-Unis semble pour sa part avoir connu une longue éclipse après sa retraite en 1974 et l’absence de son travail dans les discussions sur les sciences de l’image d’ascendance warburgienne a déjà été relevée3.
Ce que les travaux de Blakinger et Bolay ont en commun, c’est qu’ils placent quant à eux Kepes au centre d’une enquête monographique et ne le perçoivent plus seulement comme représentant d’une situation contextuelle plus large. Une telle approche, directement liée aux conditions d’accès aux archives, doit être saluée : les quelque 33 mètres linéaires d’archives privées de Kepes ont été acquises par l’université de Stanford en 2010 et y ont été organisées par Blakinger lui-même. Grâce à cette connaissance approfondie du fonds, l’auteur est en mesure de présenter des documents orignaux de manière raisonnée : au-delà d’une biographie critique attendue depuis fort longtemps, l’ouvrage revient sur le corpus d’études de Kepes sur le camouflage4 et propose une tentative de reconstitution complète du Light Book susmentionné. L’étude de Bolay s’appuie quant à elle plutôt sur du matériel déjà publié, que l’auteur éclaire en le confrontant à de nouveaux contextes, donnant notamment un aperçu des travaux de Kepes sur l’urbanisme, la signalisation et la théorie de la perception. S’y ajoute une théorie de l’ornement qui, s’appuyant sur John Ruskin et William Morris, permet d’ancrer de manière plus tangible le concept assez diffus d’ordre développé par Kepes. Tandis que Bolay, dans une attitude plutôt défensive, s’efforce de lisser par l’argumentation les apories de l’œuvre de l’artiste, Blakinger en dresse un portrait aux facettes multiples, dans un texte marqué par son élégance dialectique et sa clarté. Le travail de Blakinger ne craint aucunement de se confronter aux contradictions évidentes de la vie et de l’œuvre de Kepes. On a même parfois l’impression que ce sont précisément ces tensions qui produisent des perspectives inattendues. C’est ainsi que se révèle un Kepes imprégné de rhétorique moderne, mais ne conduisant ni voiture ni bicyclette et qui – la référence à Giedion apparaît une fois encore – vit dans un vieux chalet sans télévision. Lorsque Kepes baigne dans les fantasmes de rayons thermonucléaires tout en affirmant ses visions de paix, on pense au Dr Strangelove, et on retrouve effectivement dans cette biographie certaines des ambiances brûlantes de la guerre froide caricaturées dans le film culte de Kubrick.
Pour Undreaming the Bauhaus, Blakinger emprunte le sous-titre de sa monographie à une note de Kepes. Undreaming ? Selon lui, le titre décrit un processus qui débute dans l’ouvrage par l’autoportrait constructiviste de Kepes de 1930 pour se terminer avec sa mise en scène par le photographe attitré du MIT en 1967. Si l’on envisage cet undreaming comme une manière d’auto-évalution, cela présupposerait, de façon un peu paradoxale, que le rêveur se reconnût comme tel et souhaitât se réveiller. Or, l’apparente indifférence avec laquelle Kepes a appréhendé certains événements de son époque, mais aussi certaines critiques ouvertes faites à son œuvre, laisse apparaître un soupçon de rêverie. C’est ici l’esprit même de l’utopie que l’on imagine à l’œuvre, esprit dont la part poétique a su libérer un potentiel créatif teinté de résistance et qui, peut-être, permettrait d’expliquer la fascination persistante que le travail de Kepes a suscitée. Pour ce qui est du revers d’une telle utopie, Sybil Moholy-Nagy – qui tout au long de sa vie fut une critique sévère de Kepes –, livra en 1968 un jugement cinglant, mais lucide, sur le Bauhaus vieillissant : sous le titre caustique de Hitler’s Revenge5, elle pointa les courants totalitaires sous-jacents à l’esprit du Bauhaus, qui à cette époque, à travers la rencontre des « Grauhäusler » – ces « Bauhäusler » marqués par l’avancée de l’âge – et de Philip Johnson, menaçaient de bétonner Manhattan intégralement. Rêver le progrès ou se réveiller6 : le prisme du somnambulisme aiderait sans doute à briser cette dichotomie. La vie et l’œuvre de György Kepes offrent pour cela un modèle exemplaire.</p>
Dans ce contexte, la vie et l’œuvre du photographe, théoricien, enseignant et scénographe d’exposition György Kepes (1906-2001) font figure de modèles. Ayant grandi en Hongrie, Kepes suit une formation d’artiste à Budapest. Là, la répression de la République des conseils hongroise participe à son engagement politique et le rapprochement avec le cercle de Lajos Kassak le met en contact avec l’avant-garde européenne. Kepes devient bientôt l’assistant de László Moholy-Nagy, qui dirige un bureau de publicité à Berlin après avoir quitté le Bauhaus en 1928. Il le suit à Londres en 1935, puis au New Bauhaus de Chicago en 1937. Pendant la guerre, il œuvre comme spécialiste du camouflage pour l’armée américaine. À partir de 1947, il est chargé de cours à la School of Architecture and Planning du MIT, où il fonde en 1968 le Center for Advanced Visual Studies (CAVS), qu’il dirigera jusqu’à sa retraite en 1974. Kepes s’éteint en 2001 à l’âge de 95 ans à Cambridge, dans le Massachusetts.
Les deux monographies de John R. Blakinger et de Jean-Marie Bolay enrichissent la littérature sur György Kepes de manière significative, ce dont on peut d’autant plus se réjouir pour le champ francophone. Cette multiplication des points de vue est particulièrement bienvenue dans le cas de Kepes, personnage aux facettes multiples, qui articula sur une période très longue un nombre important de thèmes, de méthodes et de topographies. Son travail éditorial, mené sur plusieurs décennies, constitue probablement l’activité qui a laissé l’héritage le plus visible : The Language of Vision, son premier livre, en 1944, issu de ses réflexions sur la Gestalttheorie, trouvera ainsi un écho durable – chez les artistes surtout, dans une moindre mesure chez les historiens d’art. Blakinger y localise « une forme d’art propre à Kepes : l’essai visuel », là où son œuvre commercial, graphique ou photographique ne sut jamais complètement se débarrasser de l’impression d’un certain manque d’originalité. La forme de l’essai visuel marque notamment de son empreinte la colossale entreprise éditoriale Vision+ Value (1965-1972), collection de livres qui réunira une myriade de scientifiques, d’artistes et de penseurs, mais n’aura finalement que des effets limités sur l’interdisciplinarité. L’absence d’écho de cette « science unifiée » déployée de manière ostentatoire par la réunion de ces livres semblerait même plutôt confirmer la thèse des Deux Cultures de C.P. Snow. À l’inverse, les expositions de Kepes, The New Landscape in Art and Science (1951), Light as a Creative Medium (1965) ou Nightscape of the City, présentée à la 14e Triennale de Milan en 1968, eurent un écho considérable. Son opus magnum théorique, le LightBook – Blakinger ose la comparaison avec le Le Livre des passages de Benjamin – n’a, en revanche, jamais été publié. Quant au Center for Advanced Visual Studies, concrétisation d’une vision longtemps poursuivie par Sigfried Giedion1, sa création a coïncidé avec les manifestations de 1968 contre la guerre du Vietnam. Au moment de sa fondation, la CAVS se retrouvait donc déjà en porte-à-faux avec l’attitude anti-institutionnelle de la communauté artistique contemporaine, que Kepes avait pourtant voulu contribuer à former avec la mise en place de son institut.
Mais c’est surtout par le charme créatif de l’infatigable homme de réseaux qu’il était et par son rôle de propagateur des notions d’« interthinking » et d’« interseeing » que Kepes devint la figure du grand médiateur, presque médium lui-même, comme si, pour paraphraser son collègue Marshall McLuhan, il se mettait à incorporer en sa personne son propre message. « L’artiste est maintenant porté […] à quitter sa tour d’ivoire pour la tour de contrôle de la société2 » écrivait encore McLuhan. L’artiste ayant depuis longtemps abandonné à la technologie la position d’avantgarde qu’il revendiquait autrefois pour lui-même, sa présence dans la tour de contrôle devint effectivement un impératif. La métaphore technoarchitecturale de McLuhan doit se lire à la lumière du débat sur le rôle joué par l’artiste dans le cadre de son rattachement institutionnel – dans le cas de Kepes, une université d’élite américaine en pleine guerre froide, où il est amené, comme le souligne surtout Blakinger, à participer à un complexe militaro-industriel tout autant qu’universitaire. Ce contexte a déterminé de façon décisive les études antérieures, principalement américaines, sur la vie et l’œuvre de Kepes, avec notamment, et de la manière sans doute la plus radicale, l’enquête décisive de Reinhold Martin, The Organizational Complex. Architecture, Media and Corporate Space (Cambridge, Mass., 2003). Bien que les livres de Kepes aient été traduits dans de nombreuses langues, sa réception hors des États-Unis semble pour sa part avoir connu une longue éclipse après sa retraite en 1974 et l’absence de son travail dans les discussions sur les sciences de l’image d’ascendance warburgienne a déjà été relevée3.
Ce que les travaux de Blakinger et Bolay ont en commun, c’est qu’ils placent quant à eux Kepes au centre d’une enquête monographique et ne le perçoivent plus seulement comme représentant d’une situation contextuelle plus large. Une telle approche, directement liée aux conditions d’accès aux archives, doit être saluée : les quelque 33 mètres linéaires d’archives privées de Kepes ont été acquises par l’université de Stanford en 2010 et y ont été organisées par Blakinger lui-même. Grâce à cette connaissance approfondie du fonds, l’auteur est en mesure de présenter des documents orignaux de manière raisonnée : au-delà d’une biographie critique attendue depuis fort longtemps, l’ouvrage revient sur le corpus d’études de Kepes sur le camouflage4 et propose une tentative de reconstitution complète du Light Book susmentionné. L’étude de Bolay s’appuie quant à elle plutôt sur du matériel déjà publié, que l’auteur éclaire en le confrontant à de nouveaux contextes, donnant notamment un aperçu des travaux de Kepes sur l’urbanisme, la signalisation et la théorie de la perception. S’y ajoute une théorie de l’ornement qui, s’appuyant sur John Ruskin et William Morris, permet d’ancrer de manière plus tangible le concept assez diffus d’ordre développé par Kepes. Tandis que Bolay, dans une attitude plutôt défensive, s’efforce de lisser par l’argumentation les apories de l’œuvre de l’artiste, Blakinger en dresse un portrait aux facettes multiples, dans un texte marqué par son élégance dialectique et sa clarté. Le travail de Blakinger ne craint aucunement de se confronter aux contradictions évidentes de la vie et de l’œuvre de Kepes. On a même parfois l’impression que ce sont précisément ces tensions qui produisent des perspectives inattendues. C’est ainsi que se révèle un Kepes imprégné de rhétorique moderne, mais ne conduisant ni voiture ni bicyclette et qui – la référence à Giedion apparaît une fois encore – vit dans un vieux chalet sans télévision. Lorsque Kepes baigne dans les fantasmes de rayons thermonucléaires tout en affirmant ses visions de paix, on pense au Dr Strangelove, et on retrouve effectivement dans cette biographie certaines des ambiances brûlantes de la guerre froide caricaturées dans le film culte de Kubrick.
Pour Undreaming the Bauhaus, Blakinger emprunte le sous-titre de sa monographie à une note de Kepes. Undreaming ? Selon lui, le titre décrit un processus qui débute dans l’ouvrage par l’autoportrait constructiviste de Kepes de 1930 pour se terminer avec sa mise en scène par le photographe attitré du MIT en 1967. Si l’on envisage cet undreaming comme une manière d’auto-évalution, cela présupposerait, de façon un peu paradoxale, que le rêveur se reconnût comme tel et souhaitât se réveiller. Or, l’apparente indifférence avec laquelle Kepes a appréhendé certains événements de son époque, mais aussi certaines critiques ouvertes faites à son œuvre, laisse apparaître un soupçon de rêverie. C’est ici l’esprit même de l’utopie que l’on imagine à l’œuvre, esprit dont la part poétique a su libérer un potentiel créatif teinté de résistance et qui, peut-être, permettrait d’expliquer la fascination persistante que le travail de Kepes a suscitée. Pour ce qui est du revers d’une telle utopie, Sybil Moholy-Nagy – qui tout au long de sa vie fut une critique sévère de Kepes –, livra en 1968 un jugement cinglant, mais lucide, sur le Bauhaus vieillissant : sous le titre caustique de Hitler’s Revenge5, elle pointa les courants totalitaires sous-jacents à l’esprit du Bauhaus, qui à cette époque, à travers la rencontre des « Grauhäusler » – ces « Bauhäusler » marqués par l’avancée de l’âge – et de Philip Johnson, menaçaient de bétonner Manhattan intégralement. Rêver le progrès ou se réveiller6 : le prisme du somnambulisme aiderait sans doute à briser cette dichotomie. La vie et l’œuvre de György Kepes offrent pour cela un modèle exemplaire.</p>
Traduction de l’allemand par Claus Gunti
</div>
Référence : Mario Lüscher, « John R. Blakinger, György Kepes. Undreaming the Bauhaus, 2019 & Jean-Marie Bolay, György Kepes. Du langage visuel à l’art environnemental, 2018 », Transbordeur. Photographie histoire société, no 4, 2020, pp. 176-177.