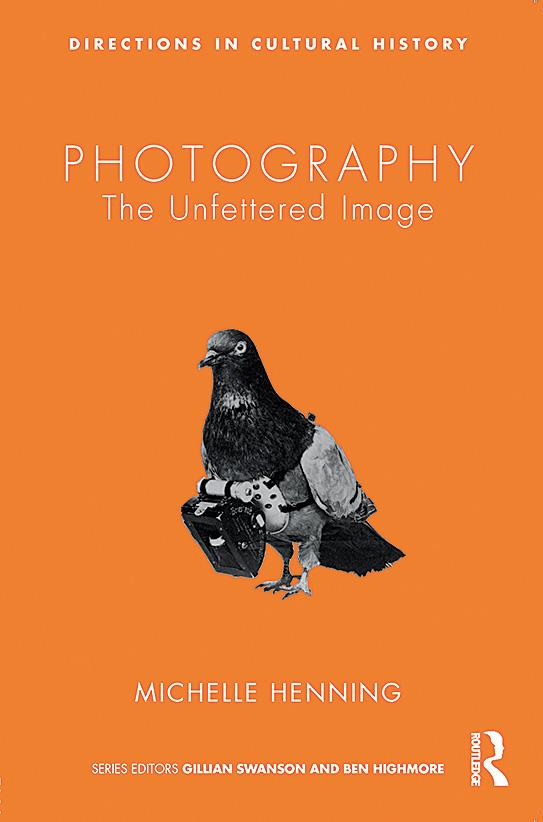
Dans ce livre aussi ambitieux que synthétique, l’historienne et artiste Michelle Henning vise à relire les discours et théories sur la photographie autour d’une hypothèse : la photographie est une image « libérée, sans entrave [unfettered] ». Face aux débats contemporains sur le partage et la circulation accrus des images qui caractériseraient la culture visuelle en régime numérique – et cherchant autant à les historiciser qu’à les relativiser –, l’auteure soutient l’idée que, dès ses débuts au XIXe siècle, la photographie est affaire de fluctuation, de fragmentation, de traduction, de projection. Si elle insiste sur le caractère mobile, voire évanescent de la photographie, cela est toujours adossé à une attention à la dimension matérielle des images et de la médiation – « l’esprit, les yeux, les mains, ainsi que lentilles, plaque de métal ou pierres lithographiques » sont les médiateurs de l’image (p. 26).
Dans huit chapitres concis, l’image est abordée dans ses dimensions sémiotiques, techno-scientifiques, discursives, et autant internes qu’externes au champ de l’art, Henning insistant sur la photographie comme « média », dans la définition élargie qu’en donnent les Medienwissenschaften germaniques ou la Media Theory anglo-saxonne1.
Le premier chapitre intitulé « The itinerant image » défend l’idée de la photographie comme catégorie impure et hybride. Il s’ouvre sur le récit d’un dentiste ayant occupé la même maison que Michelle Henning à Bristol, où il fut l’un des premiers, dans les années 1890, à investir dans une machine à rayons X pour son cabinet. Dans la demeure de ce dentiste et peintre amateur, les plaques radiographiques se mêlaient à l’appareillage d’imagerie et aux toiles postimpressionnistes accrochées aux murs. Cette anecdote ne saurait appartenir à « l’histoire de la photographie comme histoire faite de chefs-d’œuvre ou d’innovations technologiques », elle indique plutôt, à travers la rencontre dans un même lieu de la peinture et de l’imagerie radiographique, l’histoire croisée dont la photographie peut faire l’objet. Ce premier exemple est, à lui seul, illustratif de l’horizon de cet ouvrage qui vise à rediscuter les notions et métaphores canoniques de l’histoire de la photographie (la fixation du temps, l’instant décisif, l’indexicalité, la photographie comme fenêtre, etc.) par le prisme d’études de cas.
À cet égard, le quatrième chapitre, « The book of the world », offre une démonstration éloquente du travail de relecture effectué par l’auteure. Inscrit dans le prolongement de ses recherches antérieures sur l’institution et le dispositif muséal comme média2, « The Book of the world » s’ouvre sur un rappel des travaux de Stephen Bann sur le « musée publié sous la forme de tirages photographiques » ou de Walter Grasskamp à propos du rôle des publications artistiques en série dans la démocratisation de l’histoire de l’art. À travers l’exemple du Musée imaginaire de Malraux, l’auteure analyse les relations entre la reproduction photographique (l’ouvrage de Malraux incluant les clichés d’art dogon et khmer réalisés, respectivement, par Tony Saulnier et Germaine Krull) et l’émergence d’un nouveau type de musée (en rupture avec le musée-mausolée critiqué par Adorno), corollaire d’une nouvelle façon de concevoir le monde. La notion de musée imaginaire se déploie alors sur plusieurs niveaux. Malraux lui-même relevait la puissance transformatrice des techniques de reproduction sur les œuvres d’art, faisant ressortir des « similarités latentes et produisant de nouvelles affinités entre des images et des artefacts précédemment dissemblables » (p. 69). De plus, l’œuvre d’art se réincarnerait dans des fictions matérialisées par la photographie – qui se détache ici de la simple « reproduction » des œuvres –, et déployées sur les pages imprimées du livre. Dans cet élargissement du champ expérientiel des œuvres, le musée lui-même, comme la photographie, se trouve « élastique », « élargi » ou encore « dispersé ».
Si la dimension photochimique de la photographie est évoquée en passant autour de l’étude du Musée imaginaire, elle forme surtout l’objet central du cinquième chapitre intitulé « Second nature ». La possibilité d’une représentation photographique est ici replacée au sein des développements du champ de la chimie durant la révolution industrielle. Henning vise par là un double déplacement de perspective : de la photographie comme phénomène purement optique et perceptuel à ses connexions avec le marché mondial des produits chimiques, qu’ils soient d’origine minérale ou organique (comme l’aniline, à la base du développement de l’industrie des colorants de synthèse). L’auteure retrace le rôle des investissements de l’État allemand dans les universités et les laboratoires de recherche afin de rester compétitif face à la Grande-Bretagne, riche de matières premières à teinture exploitées dans ses colonies indiennes. Stratégie payante puisqu’en 1868 des chimistes allemands identifiaient la formule chimique de l’alizarine (dont on tire des colorants de nuances rouges) et qu’en 1914 les six leaders de l’industrie chimique sont allemands (BASF, Bayer, Hoechst, Agfa, Cassella, Kalle). Pour Henning, les qualités mimétiques de la photographie n’étant possibles que par ces autres matérialités et bases chimiques des gélatines, colorants et autres matériaux d’origine animale, elle qualifie ici la photographie de « seconde nature », la reproduction du monde étant fonction de l’exploitation de la nature.
Les deux derniers chapitres esquissent une généalogie de problématiques plus explicitement contemporaines. Dans le septième chapitre, « Streams and flows », Henning traite de la question des métaphores canoniques et usitées dans l’histoire des médias. Une fois de plus, l’intention de l’auteure est de redonner chair aux discours en les remettant en lien avec les supports concrets qu’une certaine « persistance des métaphores fluides » (p. 132) aurait tendance à effacer. En référence aux travaux d’inspiration bergsonienne du théoricien des médias américains Mark B.N. Hansen, Henning affirme que les discours du « flux » médiatique renvoient toujours à des « assemblages humains et technologiques qui rassemblent cognition, attention et perception avec des structures techniques intégrées, bien concrètes ou prenant la forme de médias différents » (p. 136). Elle invite donc à reconsidérer cette dimension matérielle comme étant porteuse de signification. À ses yeux, la relation médiatique n’est jamais désincarnée, mais existe toujours par des matérialités concrètes.
Enfin, dans le chapitre final « We are here, but where are you? », l’historienne reconsidère des photographes canoniques dans un dialogue avec certaines pratiques et discours de l’art contemporain. Walker Evans, Louise Dahl-Wolfe, Helen Levitt et Robert Frank y sont convoqués pour leur capacité à remettre en question les limites de la représentation. Le titre du chapitre est emprunté à la photographie prise par John Gutmann à San Francisco en 1936-1937 : sur une palissade en bois parsemée d’inscriptions et de marquages, on peut lire ce graffiti : « DEAR Sophie ANd MAE / WE are here but where / Are you? AugusT 10, 1936. ». Henning considère cette photographie comme un exemple de « pure reproduction » – telle la photocopie d’un document. Dans cette image « plate » qui se présente comme simple texte destiné à être lu, l’auteure voit la possibilité de capturer une dialectique de l’absence et de la présence : l’enregistrement d’expériences « transitoires, itinérantes », évocatrices des expériences sociopolitiques d’une époque, permet de relativiser toute velléité de les représenter de façon immuable, stratégie qu’elle rapproche des positions d’Okwui Enwezor sur la question du documentaire dans l’art contemporain3.
La grande qualité de Photography. The Unfettered Image est de cartographier des territoires qui excèdent bien souvent le prisme de l’histoire et de la théorie photographiques. Si les noms bien établis dans le domaine sont certes présents (Roland Barthes, Walter Benjamin, Susan Sontag), ils y côtoient toute une série d’auteurs (Wolfgang Ernst, Mark Hansen, Friedrich Kittler, Bruno Latour) qui chacun à leur façon mettent l’accent sur la matérialité ou la concrétude des médias, des régimes de médiation et de la technique. Grâce à ces théoriciens, Henning établit un dialogue fertile entre histoire de la photographie et archéologie des médias : les notions de mobilité et de matérialité forment les pivots conceptuels et méthodologiques du livre. Loin des récits internalistes de l’histoire de la photographie, qui tendent à refermer cette histoire sur elle-même, l’ouvrage veut relire la photographie dans le contexte plus large du développement des technologies médiatiques et des ambitions impérialistes européennes. Aux antipodes d’une histoire linéaire des circulations photographiques, la volonté de montrer la photographie « sans entrave » se répercute dans la forme même du livre qui combine caractère fragmentaire et logiques ouvertes de montage. Enfin, Photography. The Unfettered Image de Michelle Henning est une tentative réussie de nuancer le postulat selon lequel le temps des images digitales aurait profondément transformé ce qui caractérisait les photographies : en réalité, l’histoire de la mobilité photographique s’était ouverte bien plus tôt et sous de nombreux visages.</div></div>
Référence : Adeena Mey, « Michelle Henning, Photography. The Unfettered Image, 2018 », Transbordeur. Photographie histoire société, no 3, 2019, pp. 208-209.