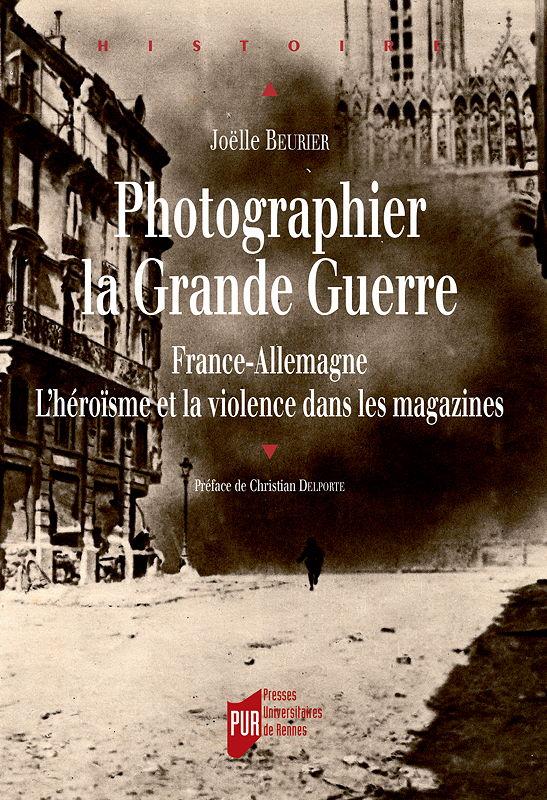
À qui estimait que l’historiographie de la Grande Guerre était entrée dans un temps de la pure pédagogie et qu’on laissait derrière nous, avec le souvenir enflammé des débats sur la « culture de guerre », le temps de la recherche de première main, de la découverte de nouvelles sources, à qui jugeait en somme le sujet épuisé, le Centenaire est venu apporter un démenti. La transmission de cette histoire entraînait de facto la nécessité d’ouvrir de nouveaux dossiers et de réfléchir justement sur les formes de la médiatisation visuelle passée et présente du conflit. Pour parler aujourd’hui de la guerre, il faut s’interroger sur les récits, les mythes, les imaginaires, les visions, ou plus exactement, dès lors qu’on pense au travail des musées d’histoire, aux objets, témoignages, images qui furent produits dans le temps du conflit. Et puisqu’on n’étudie plus la figure du soldat inconnu qu’en regard de celle du combattant anonyme, qu’aux figures héroïques est venue se conjuguer une connaissance plus fine de l’expérience vécue, l’historien est conduit à un va-et-vient constant entre le témoignage et le mythe, trouvant dans l’écart une vertu heuristique. C’est justement dans cet écart que viennent se loger les objets d’une médiation impossible entre l’expérience du combat et l’avidité de connaître, de savoir, de s’imaginer ressentie à l’arrière. Objets, lettres, dessins, photographies, autant de fragments pour une reconstruction de l’expérience de guerre, dont l’historien se nourrit prudemment pour comprendre quelle fut la conscience du conflit chez celles et ceux qui ne l’ont pas vécu.
Contre toute attente – faisons provisoirement abstraction du travail de Laurent Véray sur le cinéma, qui mériterait une discussion séparée –, l’état de la recherche sur les photographies de la Grande Guerre était, en France en 2014, extrêmement maigre, si on le compare à l’historiographie d’autres pays européens : en Grande-Bretagne, le premier livre sur la question, celui de Jane Carmichael, First World War Photographers aux éditions Routledge, date de 1989 ; en Allemagne, la thèse de doctorat de Bodo von Dewitz, So wird bei uns Krieg gefürt! Amateurfotografie im Ersten Weltkrieg, Munich, tuduv, 1989, fut une des nombreuses sources de la célèbre exposition du Deutsches Historisches Museum et de son catalogue, Die letzten Tage der Menschheit. Bilder des Ersten Weltkrieges, Berlin, 1994 ; ou encore en Autriche, avec un ouvrage de référence d’Anton Holzer, Die Andere Front. Fotografie und Propaganda im Ersten Weltkrieg, publié à Darmstadt en 2012. Les fondateurs de l’école de Péronne se sont finalement moins intéressés aux images qu’aux témoignages écrits, avant qu’Annette Becker produise récemment sur la question des arts visuels quelques travaux fondateurs – notamment un ouvrage, Voir la Grande Guerre. Un autre récit, Paris, Armand Colin, 2014, emboîtant le pas à Philippe Kaenel et François Vallotton – Les Images en guerre (1914-1945). De la Suisse à l’Europe, Lausanne, Antipodes, 2008. Avec le Centenaire s’est révélée également une génération nouvelle – Christina Kott sur la question de la protection du patrimoine, Emmanuelle Danchin sur les paysages de ruines, Marine Branland sur les graveurs, Hélène Guillot sur la Section photographique de l’armée. Ce fut le cas notamment lors de l’exposition Vu du Front. Représenter la Grande Guerre réalisée pour la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) et le musée de l’Armée par Caroline Fieschi, Benjamin Gilles et Antony Petitot notamment, qui avait l’avantage, outre sa richesse et sa qualité, de battre en brèche deux idées reçues largement véhiculées par l’historiographie : d’abord qu’en dépit de l’interdiction édictée par les états-majors, les soldats ont abondamment photographié le conflit, perpétuant une pratique qui remonte à la guerre des Boers et à la guerre russo-japonaise ; ensuite que la photographie n’a pas tué les arts plastiques, et qu’elle a bien plutôt accompagné la mutation du dessin et de la gravure. Les sources sont d’ailleurs loin d’être épuisées, à l’exemple de la collection d’autochromes du musée départemental Albert-Kahn actuellement en cours de documentation.
L’ouvrage de Joëlle Beurier, qui fait suite à une thèse soutenue en 2006 à l’Institut universitaire européen de Florence, s’inscrit dans ce contexte foisonnant et se distingue par sa densité et son approche comparée franco-allemande. Il s’ouvre dans sa première partie sur la mobilisation et le traitement des figures de l’ennemi, où il apparaît qu’en France s’affirme rapidement une stratégie de déshumanisation du soldat allemand quand, en Allemagne, le respect s’impose face à l’ennemi, qui n’est « pas méprisé mais défait ». D’emblée apparaissent les continuités avec la période précédente, par exemple la culture des représentations folkloriques et pittoresques en Allemagne, qui conduisent l’auteure à emprunter la notion de « culture de guerre » plutôt que de celle de propagande, notion utilisée d’ailleurs avec circonspection dans tout l’ouvrage, tant les mécanismes de la production, du contrôle et de la censure dépendent d’une culture de l’image indépendante de la volonté des états-majors. Les pratiques photographiques observées au chapitre 2 imposent également la prudence quant à l’idée d’une propagande : dans aucun des deux pays les reporters n’arrivent en première ligne, qu’ils soient reporters privés accrédités (en Allemagne Kriegsberichterstatter) ou au service de l’armée. Ils produisent un matériau documentaire insipide jugé inexploitable par la presse française, alors que la presse allemande, contrôlée de beaucoup plus près, génère une image édulcorée et idéalisée du théâtre des opérations. Dans les deux camps, les soldats photographient massivement, mais il n’y a qu’en France que la presse fait abondamment appel aux amateurs pour illustrer les magazines. Cette partie sur la production des images est très convaincante, même si son modèle est abandonné par la suite au profit d’une démarche plus iconographique.
La deuxième partie évoque les violences montrées et cachées par les magazines, en premier lieu la représentation de la mort. En France, on observe un mouvement croissant de la visibilité des horreurs de la guerre, et Le Miroir est le magazine qui se distingue le plus vite du modèle héroïque de L’Illustration : en septembre 1914, la mort est encore euphémisée ; en octobre apparaissent, avec les croix et les scènes de funérailles, les premiers cadavres ennemis dont le nombre augmente progressivement en novembre et, en janvier 1915, est franchi le cap de la représentation d’un cadavre français. Toutes ces images sont des photographies d’amateurs que Le Miroir encourage par des concours, et si elles échappent à la censure, c’est qu’elles ne contiennent aucune information délicate du point de vue militaire. En Allemagne au contraire, le contrôle s’effectue en amont, sur les photographes eux-mêmes, et impose la décence aux journalistes : le corps souffrant ou mutilé est absent des représentations et l’on préfère user de la litote en évoquant la mort par les symboles – les croix, les galeries de portraits d’officiers. À mesure que s’enlise le conflit, se multiplient les images du paysage de guerre, qui offrent en France un contrepoint à la vision des cadavres. Elles s’imposent à partir d’octobre 1915 et installent dans les esprits une véritable topographie du chaos : au paysage dévasté des offensives de Champagne et d’Artois succède le « paysage-ruine » de Verdun et le « paysage-poubelle » de la Somme. Côté allemand, la ruine est vectrice d’un sentiment romantique qui plaque sur la guerre la noblesse du genre paysager et permet de minimiser les effets des bombardements en installant l’image des destructions dans la tradition des vues archéologiques. On préfère éluder les combats, les seules scènes « d’action » étant des photographies d’exercices que vient compléter une « iconographie défensive » de la sentinelle.
La troisième partie fait le point sur les structures de la censure et règle le compte d’une historiographie souvent floue sur la question des images. En Allemagne, l’état-major produit de nombreux documents destinés aux éditeurs et, si la censure s’applique localement pendant les premiers mois du conflit au grand désarroi des éditeurs qui se plaignent de l’inégalité du traitement, elle est centralisée en février 1915 avec l’instauration de l’Oberzensurstelle (OZ) puis le Kriegspresseamt dont dépend l’OZ. Le Bild- und Filmamt (BUFA) créé le 1er novembre 1916 traite séparément la photographie et le film. En France, la censure est centralisée : elle dépend du gouvernement militaire de Paris jusqu’en 1916 et est intégrée telle quelle au ministère de la Guerre. Les images font l’objet de circulaires spéciales qui évoquent essentiellement la question du matériel de guerre. La subjectivité du censeur est déterminante dans l’adaptation des règles et si des velléités de collaboration plus étroite entre les services de la censure et la presse illustrée existent bel et bien, on continuera d’observer de nombreuses transgressions aux principes. Aussi la censure apparaît en France, à l’opposé de celle qui a cours en Allemagne, comme « un filet aux larges mailles ».
Le livre s’achève sur une quatrième partie où, après ce long examen sur la violence en images, se pose la question de l’héroïsme, comme une réponse à George Mosse et à son concept de « brutalisation ». En France, la figure du héros est radicalement transformée : disparition progressive des portraits de généraux – celui de Joffre par exemple ne survit pas à l’enlisement du conflit – au profit du soldat souffrant, de l’enfer qui lamine les hommes. En Allemagne, au contraire, les photographies et gravures confirment la culture de la violence et de l’héroïsme épique à travers les images de la virilité, du corps nu des soldats se baignant à leurs heures de repos, et le troupier se transforme progressivement en héros « super-réel ».
L’étude de Joëlle Beurier est un livre dense et précis, enrichi d’analyses statistiques des motifs de l’iconographie journalistique, compilées pour répondre à une question : qu’est-ce que les publics français et allemand percevaient des violences de la guerre ? Poser cette question lui permet de s’inscrire habilement dans la problématique de la « culture de guerre » pour affiner la perspective de George Mosse sur la brutalisation des sociétés européennes. Mais c’est supposer ici, au fil de l’ouvrage, une transparence de la photographie, fenêtre ouverte sur les horreurs du front. Puisque la mort est la vérité du soldat, la photographie de la mort est le réalisme par excellence. Statistiques à l’appui, l’auteure examine le réalisme français auquel elle oppose la tendance germanique à la mythologie héroïsante. Mais elle agit parfois trop en iconographe et pas assez en historienne des objets visuels. Elle semble ainsi ne pas aller au bout de la réflexion sur ce qui est spécifique à l’image, à savoir toute la stratification sémantique qu’elle accumule dans son parcours de mains en mains, du photographe au maquettiste, de la rédaction à l’imprimerie. Attachée à classer les images publiées par motifs (la mort, le paysage), elle semble oublier leur matérialité, les erreurs volontaires ou involontaires de légende, leur temporalité propre, les circulations intra- ou internationales, la chaîne de construction du discours en image. Quoiqu’il en soit et bien qu’il ne plonge pas aussi profondément qu’on pourrait le souhaiter dans l’épaisseur du médium photographique, cet ouvrage constitue un livre de référence sur l’histoire des perceptions de la guerre.
Référence : Christian Joschke, « Joëlle Beurier, Photographier la Grande Guerre, France-Allemagne. L’héroïsme et la violence dans les magazines, 2016 », Transbordeur. Photographie histoire société, no 2, 2018, pp. 220-221.