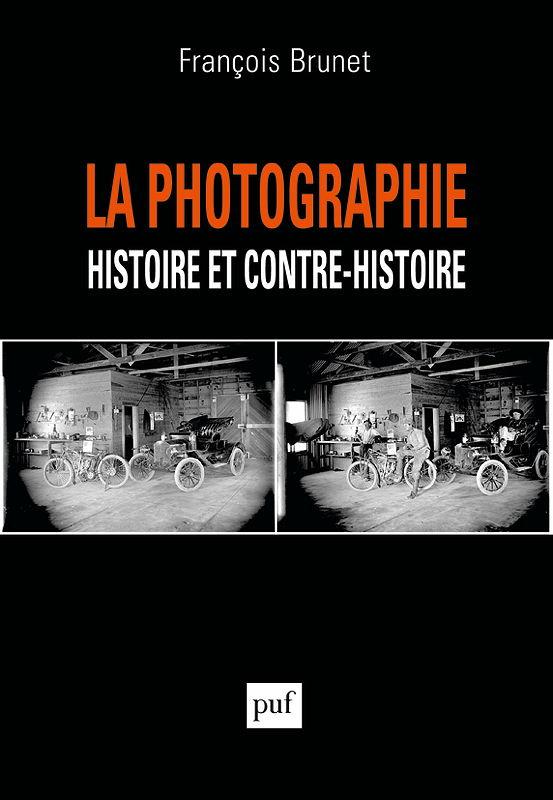
Ce n’est pas l’histoire de la photographie qui est « en vogue », mais la photographie comme histoire. Tel est le constat – incontestablement pertinent – que dresse François Brunet au début de son nouveau livre. L’auteur y arpente le vaste champ de la problématique « Photographie et histoire » en cinq grandes étapes historiques : dans la première partie de son ouvrage, Brunet retrace en filigrane les controverses qu’ont suscitées l’invention et la diffusion de la photographie : de François Arago à Oliver Wendell Holmes s’engage un débat qui tourne autour de la question de la mimesis, de la reproduction et de la copie.
Il s’intéresse dans un deuxième temps à la manière dont, aux États-Unis, on a mis au XIXe siècle l’histoire en images, plus exactement en vues stéréoscopiques, en montrant comment les amateurs, qui jouent toujours un rôle crucial quand il s’agit d’histoire, sont entrés ensuite en jeu. Dans la troisième section, il se concentre sur les réflexions qui ont fleuri autour du centenaire de la photographie et de la publication du procédé de Daguerre, les premières grandes histoires de la photographie de Georges Potonniée et Erich Stenger et, last but not least, les théories philosophiques, de Paul Valéry à Walter Benjamin en passant par Siegfried Kracauer. La quatrième partie est consacrée aux deux différentes stratégies de faire l’histoire de la photographie : Beaumont Newhall et Robert Taft incarnent deux approches opposées et incompatibles, l’une plutôt esthétique, l’autre socio-historique. Ici, comme souvent ailleurs dans son livre, Brunet explore de nouvelles sources et retrace en pointillé, à travers la correspondance échangée entre les deux historiens de la photographie, le projet théorique de chacun, où se marquent clairement les limites dans la compréhension de ce que fait l’autre. La cinquième étape nous conduit jusqu’à l’époque contemporaine et examine surtout les démarches qui veulent voir dans la photographie une véritable contre-histoire qui s’oppose à toute historiographie officielle, au « complexe militaro-industriel » à la Eisenhower ou à une idéologie. La photographie permettrait au contraire la mise au jour d’une autre histoire. Les exemples s’étendent des curieuses reconstitutions des champs de bataille de la guerre de Sécession réalisées par William Frassanito jusqu’à la littérature du trauma que W. G. Sebald illustre par des photographies, en passant par le Believing is Seeing de Errol Morris. Autant dire qu’il s’agit là d’un programme d’une prodigieuse envergure historique et aux multiples facettes. Mais quelles sont les observations de départ, quel est le diagnostic sur le présent auxquels le large éventail de ces études historico-théoriques tente d’apporter une réponse ?
Pour commencer, on peut probablement décrire la situation de façon tout à fait générale : d’un côté, de plus en plus de prises de vues sont automatiquement stockées dans de gigantesques archives électroniques, mettant ainsi le présent en images pour un futur indéterminé ; de l’autre, la théorie et les sciences de l’histoire découvrent à leur tour la photographie et se servent de ces images techniques pour écrire un genre d’histoire supposé nouveau. Dans l’espace germanophone, que l’ouvrage de Brunet, exception faite des exemples classiques de Benjamin et de Kracauer, n’aborde que marginalement, les choses sont poussées aujourd’hui si loin qu’on reconnaît aux images en général et aux photographies en particulier une puissance historique propre et qu’on les considère comme des agents de plein droit, dotés d’un pouvoir spécifique. C’est jusque-là que vont en tout cas l’historien de l’art Horst Bredekamp dans sa théorie de « l’acte d’image » et l’historien Gerhard Paul dans diverses publications, qui sont d’ailleurs des succès de librairie. Comme dans tous les phénomènes de mode, on fera donc preuve d’une certaine prudence.
Mais que propose François Brunet face à cette situation ? De quelle stratégie dispose-t-on pour analyser ce phénomène avec la subtilité théorique et la distance critique qui s’imposent ? La réponse de Brunet est à la fois simple et compliquée. Il essaie de battre la théorie de l’histoire au moyen de l’histoire, comme dans une fin de partie aux échecs, où ne restent plus sur le plateau que deux rois qui s’affrontent. Ce qui conduit plus ou moins inévitablement, dans ce jeu, au match nul – et c’est d’ailleurs le risque que court Brunet lorsqu’il tente, sinon de porter un coup à certaines théories relativement systématiques, du moins de les expliquer en passant par les instances de l’histoire. Une autre difficulté résulte en outre de ce choc frontal : les réponses que Brunet cherche et trouve ont a fortiori elles-mêmes, en tant que théories, un ancrage historique et c’est ainsi qu’il faut d’ailleurs les comprendre, ce qui pose la question de leur statut.
En son temps, Michel Foucault avait ramené ce problème aux points de vue théorico-politiques opposés de l’archéologie et de la généalogie. Tandis que l’archéologue examine, décrit et analyse inlassablement des sédiments plus ou moins anciens de formations historiques sans jeter ne serait-ce qu’un regard sur le présent, celui qui fait de la généalogie s’efforce à l’inverse de réécrire l’histoire du présent en se penchant sur son origine. De quelle façon Brunet conçoit-il donc son entreprise ? Est-il plutôt du côté de la généalogie ou de l’archéologie ? Pour être généalogiste, il lui manque, étant donné toutes les polémiques suscitées entre-temps par l’histoire, une analyse à la fois clairement dessinée et critique du présent ; pour être archéologue, il lui faudrait au contraire renoncer à prendre en considération le présent quand il se promène dans le passé. Les théories semblent pourtant revendiquer le droit qu’on les lise en rapport avec le présent. Or Brunet est avant tout un sceptique. Il ne parle pas de l’essence de la photographie, pas plus qu’il ne favorise une théorie par rapport à aucune autre – même s’il lui arrive quand même de critiquer avec tranchant telle ou telle prise de position. Ce qui lui importe en tout premier lieu, c’est « la transformation de l’idée de la photographie en histoire( s) » (p. 13). L’adversaire est vite repéré : en France, il se nommerait par exemple Pierre Nora, lorsque celui-ci fait l’hypothèse d’« un ‹ rapprochement essentiel › entre photographes et historiens » et qu’il proclame leur affinité élective malgré les tensions qui ont marqué les débuts de leur relation. Reconstituer cette relation, tel est le véritable mérite du livre de Brunet.
On comprend sans mal que Kracauer soit à ce titre une figure phare et que Benjamin y ait également sa place. On aurait pu (et d’ailleurs sans doute dû, dans le cas de Benjamin) les lire l’un et l’autre autrement, mais c’est une part de la stratégie : certaines constellations historiques se transforment en leçons théoriques quand on pousse les oppositions frontales à leur comble, au lieu d’en décliner simplement les diverses options. Ainsi procède Walter Benjamin qui, dans sa « Petite histoire de la photographie », entreprend d’un côté une critique culturelle du présent, pour en tirer, de l’autre, différentes formes de rapport de la photographie à l’histoire. En quoi il n’est pas sans ressemblance avec Brunet : tous deux se voient confrontés à l’arrivée d’une nouvelle profusion d’images et tentent de saisir leur propre situation en faisant retour à l’histoire. La réponse de Benjamin est finalement une réponse politique, celle de Brunet une réponse historique. Il décrit trois strates temporelles distinctes, qui présentent à leur tour différentes variantes du rapport de la photographie et de l’histoire. Ainsi chaque strate se révèle-t-elle déjà comme une constellation complexe. Ce qui apparaît avec une clarté particulièrement séduisante dans la double lecture de Robert Taft, un historien de la photographie américain injustement oublié, et de Beaumont Newhall, dont la célébrité, à l’inverse, n’est pas totalement légitime. Leur correspondance, de même que la lecture et la critique croisées à laquelle ils se sont livrés, témoigne d’une profonde incompréhension pour le point de vue de l’autre. Newhall n’avait aucune sensibilité pour l’« histoire sociale » de Taft, tandis que celui-ci se fichait de savoir si la photographie était de l’art, cette question n’ayant pour lui d’intérêt que si elle était historique.
Pour comprendre aujourd’hui comment la photographie s’impose en tant qu’histoire, ainsi pourrait-on peut-être définir au mieux l’entreprise de Brunet, il faut remonter aux alentours de 1930, quand deux conceptions distinctes se font jour : l’une est « internaliste » et se soucie de la diffusion des images, l’autre est « externaliste » et s’intéresse aux archives photographiques (pp. 15 et suiv.). À quoi s’ajoute le partage entre « histoire » et « contre-histoire », qui donne son titre au livre et prend lui-même des tours extrêmement divers. Ce faisant, toute ébauche, toute conception de la photographie, nous dit Brunet, se fait sa propre idée de l’histoire. La question de savoir si Kracauer et Benjamin s’accordent dans leur critique ou si leurs avis diffèrent totalement n’est qu’un petit fragment d’une grande bataille. L’ouvrage s’ouvre par un chapitre détaillé sur les débuts de la photographie, qui fait appel, comme les autres sections du livre, à une profusion de documents et d’observations, il se clôt par un chapitre sur la marche triomphale du « ça a été », de Sontag à la photo-littérature du trauma d’un Sebald et aux projets de fonder une « contre-histoire de la visualité » (Nicholas Mirzoeff), qui doivent naturellement s’entendre eux aussi au pluriel (p. 21). Dans ce « tour de force » historique, il se produit un rapport qui est toujours déjà configuré comme double : « une histoire de la photographie comme histoire, et comme contre-histoire » (p. 16). Et en même temps, la photographie est, d’une seule venue, à la fois récalcitrante et diverse : elle est tout ensemble bourgeoise et libérale, hégémonique et contradictoire, fondée sur des raisons économiques et culturelles, etc.
Parmi les points forts du livre, il faut signaler l’impressionnante richesse des matériaux et l’aisance avec laquelle Brunet se promène à travers les siècles et les théories. Si tout n’y est pas neuf, comme il va de soi, l’ouvrage présente néanmoins une quantité de constellations absolument éclairantes, comme les couples Stenger et Potonniée ou Taft et Newhall, ainsi que le groupe réuni autour de Barthes, Sontag, Frassanito et Errol Morris. Mais la tentative de battre la théorie de l’histoire – ou une théorie qui se donne comme telle – avec ses propres armes, c’est-à-dire au moyen de l’histoire, eût tout de même requis pour finir une théorie spécifique, afin de pouvoir quitter la place en vainqueur. Brunet développe une telle théorie « en passant », en disséminant de nouveau d’un geste théorique des concepts comme l’« image-document », l’« image-événement » ou l’« événement-image », sans les relier toutefois en système. Ainsi les concepts brillent-ils un peu comme des feux follets çà et là dans le livre, qui tient sa force de ses complexes et lumineuses balades à travers l’histoire, laquelle se transforme en histoires au pluriel. Cet impératif du pluriel est le coeur théorique du livre. Entre le « mal d’archive » de Derrida et le nouvel archiviste de Foucault, Brunet trace un chemin qui se conçoit comme une histoire critique de la théorie.
Traduction de l’allemand par Jean Torrent
</div>
Référence : Bernd Stiegler, « François Brunet, La Photographie. Histoire et contre-histoire, 2017 », Transbordeur. Photographie histoire société, no 2, 2018, pp. 222-223.