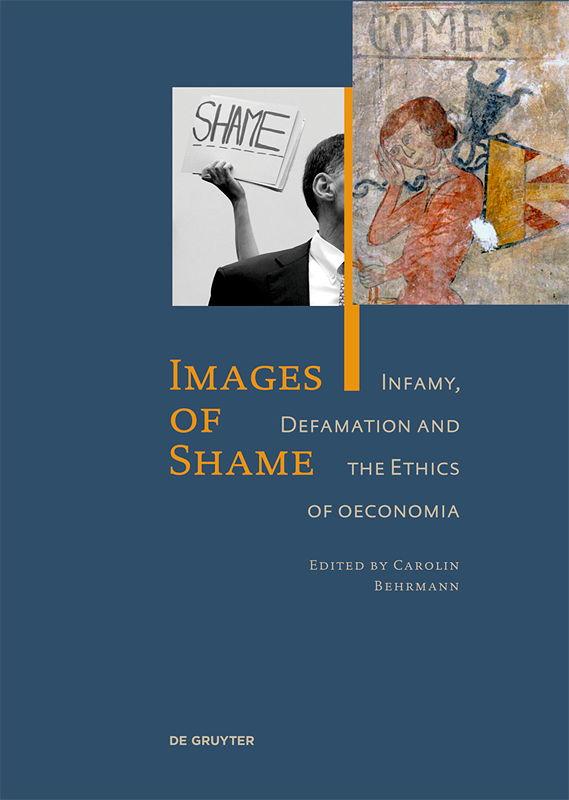
Aux effigies, aux panthéons des grands hommes, aux portraits de dignitaires, l’usage et le droit opposent les « images infamantes ». Produites, dans le passé, à la suite de décisions judiciaires ou politiques pour brocarder les faux-monnayeurs, les magistrats corrompus, les débiteurs insolvables, pour salir la mémoire des souverains renversés ou pour punir conspirateurs et régicides, les images infamantes sont de celles qui frappent la réputation des personnes qu’elles représentent. Les peintures réalisées à fresque sur les murs des communes de Toscane et d’Émilie-Romagne ou les lettres d’infamie placardées dans les rues des villes d’Europe centrale étaient, à la fin du Moyen Âge et durant toute l’époque moderne, selon Gherardo Ortalli « une donnée interne et constitutive d’un système d’images public, officiel et laïc » (La Peinture infamante, 1994, p. 16). Certes, la transformation de l’espace public aux XVIIIe et XIXe siècles, dont la photographie et la presse furent l’un des moteurs, a bouleversé cet ordre ancien du droit qui régissait les rapports entre dignité et infamie dans le système des images. La période contemporaine a sa logique propre en la matière. Mais on ne peut aujourd’hui comprendre le rôle des représentations visuelles dans la construction de la réputation, l’articulation entre l’usage et le droit des images, sans revenir à cette période fondatrice de la culture visuelle occidentale.
La littérature sur la question est connue, mais elle est ancienne : Wolfgang Brückner a abordé cette question dans son livre Bildnis und Brauch. Studien zur Funktion der Effigies (Berlin, 1966) ; Gherardo Ortalli a écrit un ouvrage extrêmement important, « Pingatur in Palatio… ». La pittura infamante nei secoli XIII-XVI (Rome, 1979)1, qui inspira à David Freedberg son fameux Power of Images. Studies in the History and Theory of Response (Chicago, 1989). S’ajoute à ce trio fondateur, une étude plus récente sur les lettres d’infamie en Europe centrale par Matthias Lentz, Konflikt, Ehre, Ordnung. Untersuchungen zu den Schmähbriefen und Schandbildern des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit (ca. 1350-1600) (Hanovre, 2004).
Les articles rassemblés pour cette publication par Carolin Behrmann comprennent, comme un hommage à leurs travaux, les trois figures canoniques de cette historiographie. Ils reviennent sur leurs anciennes conclusions et font le bilan des études plus récentes. S’y ajoutent des textes montrant la vivacité du champ et les pistes nouvelles qui s’ouvrent aux chercheurs. Comme pour éviter les amalgames quant à la définition des « images infamantes », certains articles de l’ouvrage distinguent différents types de pratiques visuelles. Le texte de Karl Härter présente une synthèse sur l’histoire des peines infamantes qui sont constitutives du système pénal en Occident, où la ritualisation des peines afflictives participe elle-même de l’infamie du condamné. Wolfgang Brückner revient sur un des écueils de l’ethnologie du XIXe siècle, qu’il avait déjà identifié dans ses précédents travaux : la notion de « magie » que James George Frazer avait mise en avant est une impasse méthodologique quand il s’agit d’expliquer tant les œuvres votives – par exemple le culte des boti dans la Florence du XVIe siècle – que l’image infamante ou l’exécution in effigie. La fonction substitutive des portraits, par laquelle une image a le pouvoir de représenter une personne en son absence, ne peut s’expliquer par la notion de magie ou par quelque autre « superstition ». Elle appartient à un système juridique ou social et se trouve limitée à une action précise. Il en va de même des images qui frappent d’infamie les personnes qu’elles représentent. En renonçant à la notion controversée et à vrai dire inopérante de « magie », Brückner parvient à décrire un éventail de types qui vont de la peinture infamante du Moyen Âge à la caricature contemporaine et à la photographie. Gherardo Ortalli est plus précis encore. Il insiste sur la définition de trois ordres d’images à l’époque médiévale, qui ne doivent pas être confondus. D’abord, les peintures infamantes des États communaux d’Italie du Nord entre le XIIIe et le XVIe siècle : portraits de condamnés – opposants politiques, juges corrompus, faux-monnayeurs, etc. – commandés à des artistes à la suite de condamnations pénales pour orner les murs de palais communaux et de places de marché. Ensuite les lettres d’infamie d’Europe centrale du XIIIe au début XVIIe siècle, dans lesquelles sont brocardés les débiteurs insolvables. Celles-ci ne sont pas la conséquence de jugements publics, mais d’initiatives privées menées par des créditeurs. Enfin, il y a l’exécution in effigie, où un condamné jugé par contumace voit son mannequin pendu ou brûlé sur la place publique. On peut citer parmi les cas les plus tardifs d’exécutions d’effigies, celui du comte Gyula Andrássy dans la ville de Pest, condamné en son absence en 1849 par un tribunal militaire après avoir pris fait et cause pour la révolution. Ici s’applique la fonction représentative de l’image, mais l’acte est pure réplique de la peine capitale – elle ne constitue pas en elle-même un châtiment.
Sur la peinture infamante dans l’Italie du Moyen Âge, qui constitue le terrain historique des recherches d’Ortalli, Matteo Ferrari et Giuliano Milani ont été capables récemment d’apporter de grandes avancées. C’est là un des dossiers les plus passionnants de cet ouvrage. À l’issue d’une recherche menée ensemble dans les archives des communes, ils ont pu préciser le contexte technique, matériel, juridique et iconographique de la pratique des images infamantes. Milani explique avec beaucoup d’exactitude le passage d’une pratique où l’image avait pour seule fonction d’accompagner la peine afflictive à une pratique où l’image constitue en elle-même un châtiment symbolique. Ce passage se fait au milieu du XIIIe siècle, au moment où est introduite la peine du bannissement – temporaire ou définitif – de la communauté. La condamnation à voir son portrait peint sur le mur d’un bâtiment public serait en quelque sorte « performative », un « acte d’image » comme le dirait l’historien d’art Horst Bredekamp, dans la mesure où elle manifeste publiquement le bannissement dont elle est le moment déclencheur. Le texte de Thomas Ricklin développe lui aussi ce thème en revenant sur un fait saillant mais peu documenté de la biographie de Dante. Le gouvernement guelfe de Florence proposa à l’auteur de la Divine Comédie de retourner dans sa ville natale en 1315, après treize années d’exil, lui offrant le pardon contre l’amende honorable. Dante refusa de se soumettre à ce rituel de l’oblatio, qui exigeait un court séjour en prison puis une déclaration publique demandant pardon pour les offenses commises contre le pouvoir. Le lien entre l’image infamante et le bannissement explique aussi, selon Milani, le recours à une iconographie de la damnation dans les images infamantes, représentant le condamné avec une bourse autour du cou en référence à l’homme riche de la parabole de Lazare. En effet, comme l’avait déjà clairement établi Johan Huizinga dans Homo ludens (1939), il existe une hiérarchie des péchés dans la culture médiévale, qui place en première ligne l’avarice. C’est de ce constat d’un lien essentiel entre la criminalité économique et l’origine des images infamantes que le livre tire son sous-titre « Ethics of oeconomia ».
Le passage à l’ère contemporaine se fait par un élargissement de la question à la philosophie. Hana Gründler revient sur un moment fondateur de l’éthique contemporaine, lorsqu’Emmanuel Levinas fait de la perception du visage d’autrui le lien de responsabilité essentiel, appelant le sentiment d’humanité et ouvrant sur un infini. Or cette épiphanie du visage de l’autre pose selon lui toute représentation comme une impasse dès lors qu’elle clôture le sujet par son objectivation même. Elle enferme son humanité dans une forme figée. Cette position de Levinas aurait pu avantageusement être complétée par une réflexion menée ailleurs dans l’ouvrage à propos des pratiques et du droit des images à l’époque contemporaine. Certes le texte de David Freedberg, qui rappelle une expérience récente faite lors de son retour en Afrique du Sud après trente années d’exil politique, nous parle des rapports entre genres, dignité et pouvoir politique aujourd’hui. Mais la question de l’espace public, du contrôle de l’image publique par le pouvoir politique auraient sans doute mérité d’autres études. Il en va de même de la question de la caricature, qui était d’ailleurs annoncée par le texte passionnant de Felix Jäger. Ce dernier compare de manière saisissante un corpus de masques d’infamie des XVIe et XVIIe siècles avec une série de casques d’armures de parade qui présentent, malgré leurs fonctions différentes, des similitudes dans l’accentuation des traits animaux et grotesques. Cette iconographie semble annoncer le portrait-charge du XIXe siècle, évoqué succinctement dans l’introduction du texte mais absent du reste de l’ouvrage. Qu’en est-il également du rôle de la photographie dans l’évolution de l’économie et du droit des images ? Certes, le livre s’achève sur une étude du rayon X comme archétype du paradigme indiciaire, mais, dans son article, Piyel Haldar n’aborde que de manière très générale cet aspect, qu’il compare aux portraits de cire de l’époque romaine pour esquisser une interprétation de l’évolution des « médiations de la subjectivité ». Or il y a, dans la redéfinition même de l’espace public qui s’opéra depuis le XIXe siècle, des mutations essentielles. Elles sont d’ordres tant juridique que praticotechnique : l’évolution spectaculaire de la presse illustrée entre la fin du XIXe et la moitié du XXe siècle, la question du droit à l’image, la place de la criminalité financière dans les sujets soumis à la vindicte publique, la persistance des peines infamantes dans certains systèmes juridiques occidentaux, aux États-Unis par exemple où se pratique encore le walk of shame, la question de l’influence des pratiques et du discours de l’anthropologie criminelle… C’est un champ prodigieux de problématiques nouvelles qui s’ouvre avec l’exploration du système des images à l’ère de leur reproductibilité technique. Aussi cet ouvrage, qui n’évoque l’époque contemporaine que par petites touches, doit-il être compris par les contemporanéistes comme une incitation à revenir sur l’époque médiévale et moderne pour mieux préciser les problématiques propres à notre époque.
</div>
Référence : Christian Joschke, « Carolin Behrmann (dir.), Images of Shame. Infamy, Defamation and the Ethics of oeconomia, 2016 », Transbordeur. Photographie histoire société, no 2, 2018, pp. 2018-2019.