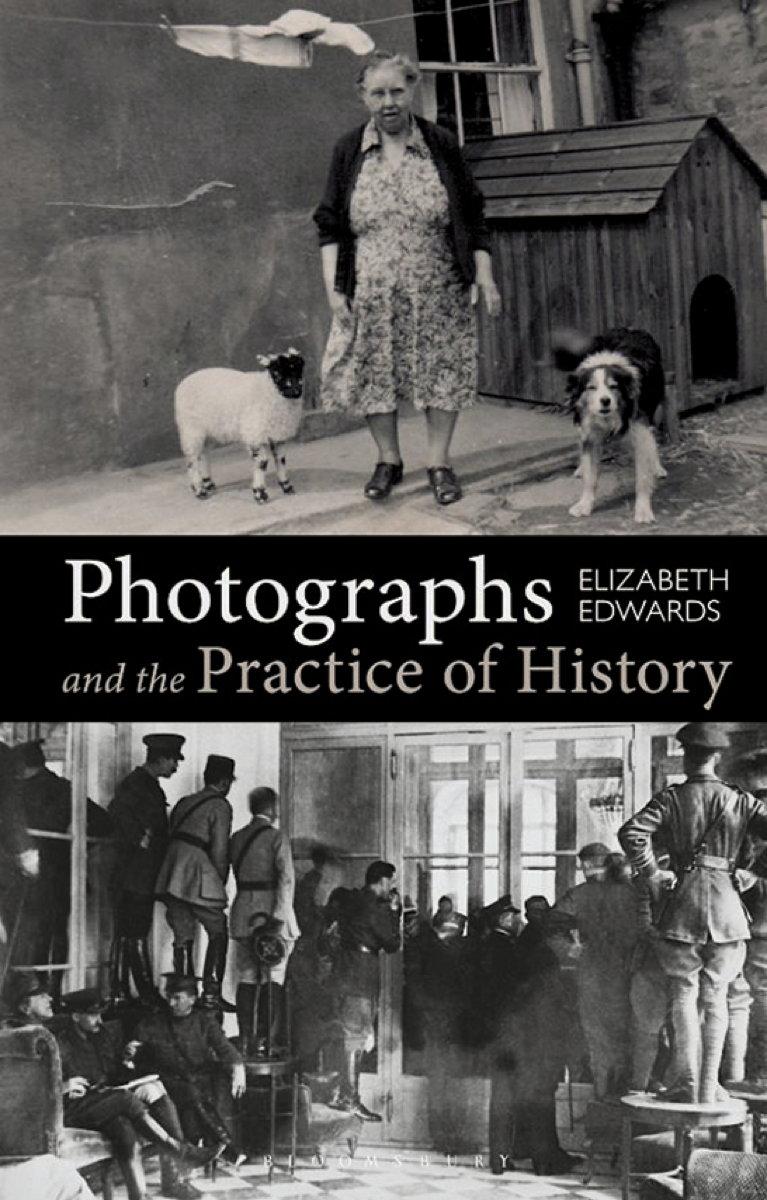
Dans cet ouvrage court mais dense, Elizabeth Edwards livre une réflexion riche sur les interactions entre photographie et pratique de l’histoire. Conçu comme une série d’essais, le volume examine en profondeur ce que W.T.J. Mitchell a appelé les sites de « perturbations historiques » créés par les photographies dans tous les domaines de l’histoire. Il vise ainsi à combler un certain manque de réflexivité dans le traitement des sources photographiques. Aussi, au lieu de proposer une méthodologie générale pour traiter de ces sources, l’auteure met au jour une « gamme de sensibilités historiographiques fluides et de réflexions critiques et réflexives » (p. 4) destinée aux historiens et aux étudiants, et applicable à un vaste faisceau de pratiques historiques. L’auteure explore cet « espace de pensée » (think-space en anglais) à travers huit éléments fondamentaux de l’analyse historique qui structurent le livre en autant de chapitres : l’inscription, la distance, l’échelle, l’événement, la présence, le contexte, la matérialité et le numérique.
Elle passe au crible les interactions entre les photographies et les pratiques de l’histoire depuis la création du médium au XIXe siècle. L’histoire des époques antérieures à 1839 est aussi concernée, car les photographies sont imbriquées dans les modes de représentation et de transmission de l’histoire de toutes les périodes. S’il est désormais convenu que les notions de temps, d’espace, d’expérience et de mémoire ont toutes été reconfigurées à l’ère photographique, Edwards précise dans cet ouvrage les conséquences de ces reconfigurations sur la pratique et la perception de l’histoire.
Ancré dans l’ontologie et l’épistémologie de l’histoire, le livre est pertinent bien au-delà de l’histoire de la photographie et des études visuelles. Ainsi, outre sa propre expérience d’historienne, Edwards fait appel à de nombreux travaux d’anthropologie historique, de philosophie et de théorie de l’histoire. Prenant comme point de départ l’idée d’Eduardo Cadava d’une assimilation de la pensée historique à la photographie et la notion d’« historiophoty » d’Hayden White, Edwards examine comment, concrètement, « les objets du savoir et les paramètres de l’entendement » (p. 2) sont façonnés par les photographies, et vice versa. L’auteure apporte ainsi une réflexion épistémologique et pose un appareil théorique qui cerne les enjeux des photographies pour l’histoire, notamment en reprenant des théories courantes dans les études photographiques. Alors que Walter Benjamin, Siegfried Kracauer ou Roland Barthes ont vu dans les photographies un engagement philosophique ou métaphorique, Edwards, elle, y voit une source de questionnement historiographique. Sans minimiser leur importance, elle met néanmoins en garde contre une certaine naturalisation de ces théories de la photographie dans le travail historiographique.
Le premier chapitre traite de l’« inscription photographique », soit l’élément de perturbation historique le plus important apporté par la photographie. L’auteure soutient que les photographies sont comparables à d’autres formes de sources historiques en leur qualité d’« actes de traduction et de médiation entre objet et sujet, entre les mondes et leur compréhension et interprétation » (p. 19). Cependant, les spécificités des captures photographiques, comme leur caractère « incontrôlé », la multiplicité des intentions et l’inscription d’une pléthore de détails, dont beaucoup échapperaient à l’opérateur, les rendent particulièrement pertinentes pour les approches affectives et expérientielles apparues récemment dans l’historiographie. Les détails de la vie quotidienne et la granularité fine des descriptions photographiques pointent la densité de l’expérience vécue dans le passé. Par extension, cette abondance de détails du quotidien d’apparence banale stimule la recherche d’un même niveau d’information dans d’autres types de sources. Ainsi, affirme Edwards, les photographies « infléchissent nos relations au passé » (p. 23) et participent à l’expansion et à la redistribution des savoirs. L’essor de l’histoire sociale, culturelle et anthropologique dans la seconde moitié du XXe siècle coïncide avec celui des travaux sur les photographies anciennes dans l’histoire de la culture visuelle. Selon Edwards, la photographie aurait même contribué au développement de l’histoire de ceux qui se trouvent exclus d’autres sources : les colonisés, les pauvres, les anonymes du quotidien.
Le deuxième chapitre interroge la « perturbation distancielle » créée par les photographies dans la temporalité linéaire de l’histoire, notamment par leur capacité à donner l’impression d’une proximité avec le passé, le fameux « ça a été » de Barthes. Edwards précise cette notion en termes historiographiques en se référant à ce qu’elle appelle le « jeu distanciel » des photographies, rappelant que celui-ci a constitué l’un des aspects les plus sensationnels attachés à l’invention de la photographie. Dans l’histoire des périodes plus récentes, dans lesquelles les traumas de guerre occupent une place centrale, le rapprochement opéré par les photographies serait plus problématique, car il maintient le passé traumatique actif dans le présent. Cependant, ces images permettent également de construire des récits en dehors des cadres temporels traditionnels de l’histoire. Enfin, Edwards rappelle que les photographies du présent sont aussi perçues comme de futures traces du passé. Ainsi, leur « jeu distanciel » soulève d’importantes questions sur la manière dont elles façonnent les sensibilités au temps et participent notamment au présentisme du monde moderne, tel que le définit François Hartog.
Le troisième chapitre examine la relation des photographies à la notion d’échelle dans les pratiques de l’histoire (entre global et local, macro et micro) et en regard de l’échelle quantitative propre à ces photographies qui, à l’ère numérique, atteignent des milliards de documents. L’abondance des images photographiques présente des avantages pour la recherche. Des ensembles de données plus larges facilitent, par exemple, l’observation de phénomènes répétitifs ou de vastes structures sociales. La question de l’échelle ramène également à l’abondance des détails et à cet excès que Walter Benjamin a appelé « l’inconscient optique ». Si cela peut perturber les hiérarchies de signification dans la pratique de l’histoire, Edwards y voit la chance d’une nouvelle perspective méthodologique, une « micro-technique pour aborder de macro-questions » (p. 50). Des photographies de vies anonymes, par exemple, peuvent révéler la médiation entre les individus et les structures plus larges de la société. Finalement, l’auteure souligne la qualité performative de l’échelle : la production massive de photographies est en soi l’expression de la magnitude de certains événements, à l’instar de la Seconde Guerre mondiale, et de leur signification pour différents acteurs.
Prolongeant ce thème, le quatrième chapitre interroge la nature fragmentaire, épisodique et « éruptive » des photographies dans la perception de l’histoire depuis le XIXe siècle. Si les photographies peuvent établir des événements dans l’imaginaire collectif et historique, Edwards rappelle qu’elles ont aussi tendance à conférer aux incidents les plus banals l’apparence d’événements d’envergure. Elle propose d’intégrer ces images fragmentaires de moments fugaces dans « des axes narratifs et des questionnements plus vastes » (p. 60) et de penser « l’événement » plutôt en termes de « site événementiel », selon le concept d’Alain Badiou.
Les deux chapitres suivants traitent de la jonction entre les photographies et deux grands fondements de l’histoire : les notions de présence et de contexte. Le chapitre cinq traite de la capacité des photographies à évoquer des aspects de l’expérience sensorielle et à conférer ainsi un sentiment de « présence » à leurs sujets. Loin de nuire à l’analyse et à l’interprétation des sources, cette expérience, souvent déconsidérée, car jugée trop émotionnelle et viscérale par certains historiens, ouvre en réalité de nouvelles perspectives. Les photographies « contiennent des éléments relatifs à l’expérience et à l’être social de leurs sujets » (p. 80) et, sans en constituer des évidences irréfutables, « en rendent l’expérience néanmoins plus palpable » (p. 80). L’analyse de la présence dans les traces photographiques nécessite un « positionnement critique » qui, comme le rappelle Edwards, est « essentiel à la pratique de l’histoire » (p. 80). Le chapitre six pointe d’autres écueils de ces traces. Leur effet « réaliste » notamment induit une confusion entre contenu et contexte, les photographies étant souvent prises pour des vérités historiques, insuffisamment problématisées. Leur « volatilité » rappelle une fois de plus l’importance de la critique des sources en histoire, particulièrement dans le cas des images « iconiques », souvent comprises comme des « condensés de sens » d’un événement historique.
Les chercheurs en études photographiques et visuelles trouveront un terrain familier dans le septième chapitre sur la question de la matérialité, où il est question des formes, des modes de circulation et des usages des photographies. Cependant, Edwards souligne ici la réciprocité entre la place croissante accordée à la photographie et les nouvelles pratiques de l’histoire.Si le tournant matériel de l’historiographie a remis en question le primat de la représentation en histoire culturelle, la présence des photographies dans le paysage historique a aussi contribué à élargir les bases analytiques et empiriques d’une histoire matérielle de la culture. L’auteure rappelle l’importance des connaissances matérielles des photographies pour leur lecture en tant que sources et leur appréhension comme des agents de l’histoire, tant leurs formes matérielles reflètent les choix de leurs créateurs, commanditaires et usagers.
Dans le dernier chapitre, Edwards examine enfin comment le numérique, compris dans un sens large, met en relief les sujets discutés dans les chapitres précédents et infléchit toutes ces interactions, parfois en exacerbant certaines problématiques comme celles de l’échelle et de l’ubiquité, ou l’assimilation de l’abondance à une impression d’exhaustivité. Une postface bibliographique conclut le volume avec des commentaires détaillés sur la vaste littérature à laquelle l’auteure se réfère.
Avec ce livre, Edwards apporte une contribution significative à plusieurs disciplines. Pour les études photographiques et visuelles, cet « espace de pensée » sur des questions épistémologiques et ontologiques de l’histoire est un complément nécessaire aux ouvrages plus proprement méthodologiques comme ceux de Gillian Rose (Visual Methodologies, 2016) et Nicholas Mirzoeff (Introduction to Visual Culture, 2009). Pour d’autres disciplines, elle souligne la nécessité de comprendre l’image photographique comme une source historique avec des caractéristiques spatio-temporelles qui lui sont propres et qui infléchissent notre perception même de l’histoire. Le terme « introduction » (ou primer en anglais) dans le sous-titre s’avère ainsi particulièrement pertinent pour un livre susceptible de devenir incontournable pour tout étudiant et chercheur en sciences historiques.
Référence : Brenda Lynn Edgar, « Elizabeth Edwards, Photographs and the Practice of History. A Short Primer, 2022 », Transbordeur. Photographie histoire société, no 7, 2023, pp. 192-193.