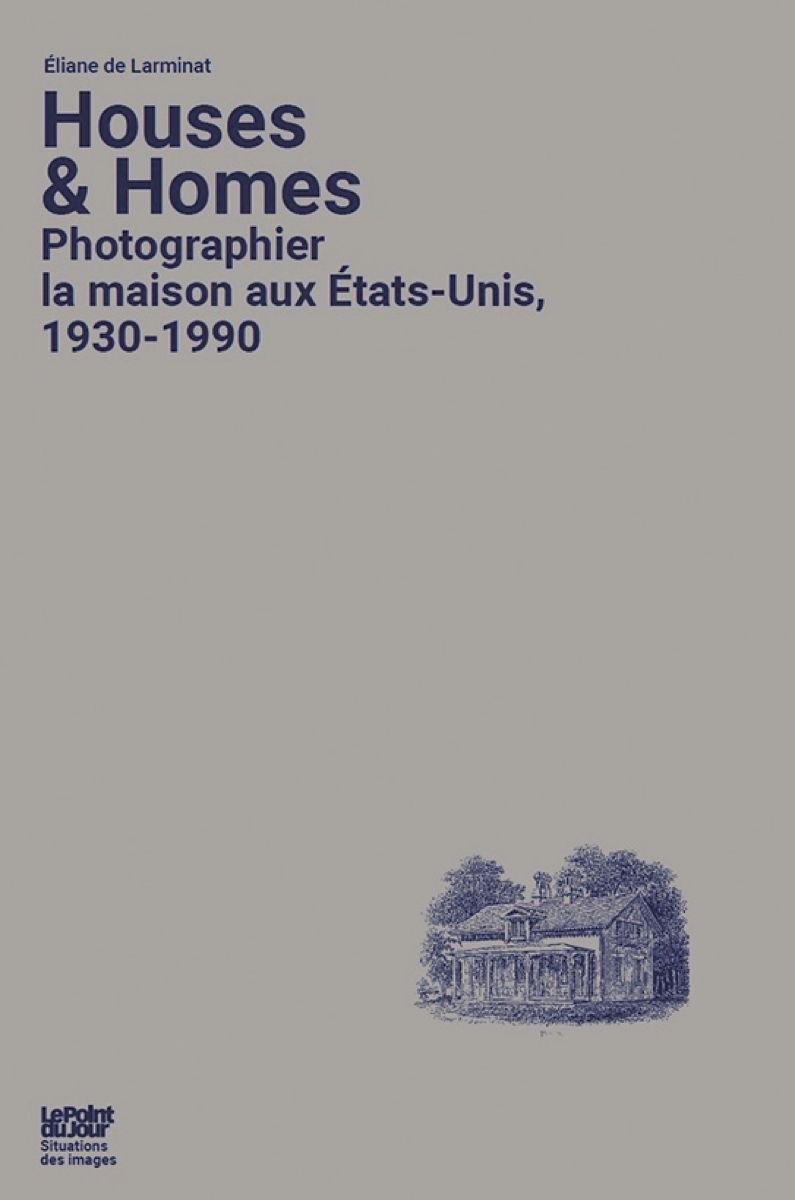
Comme il existe des « faits sociaux totaux », il y a des « objets culturels totaux » qui mobilisent autour d’eux toutes les institutions d’une société : son rapport à la parenté et à la famille, à la propriété, au territoire, aux réseaux de communication, au passé, à la forme esthétique. La maison américaine en est un. Unité structurante de la société, la maison individuelle détermine un modèle social fondé sur la famille nucléaire, la propriété privée, l’individualisme et le transport automobile. Mais elle est aussi une image. Avant de devenir, dans les années 1960, l’habitat d’une majorité d’Américains, elle était devenue un sujet central de la culture visuelle et artistique. En tant qu’objet architectural (house) ou lieu de vie (home), elle fait contrepoids aux images du gigantisme états-unien des gratte-ciel et des infrastructures agricoles ou autoroutières. Symbole de la culture de classe moyenne, argument de l’anticommunisme des années 1950-1960, son image est, pour le meilleur et pour le pire, un catalyseur de l’identité américaine – tantôt glorifiée par Frances Benjamin Johnston ou Walker Evans, tantôt raillée par Stephen Shore, Lewis Baltz ou Dan Graham, elle attire le regard des photographes comme surface, lieu d’habitation ou symbole de la spéculation économique.
L’essai qu’Éliane de Larminat consacre à ce sujet porte la marque d’une approche pluridisciplinaire de la photographie chère à François Brunet, où les analyses formelles se mêlent aux références littéraires et à l’histoire sociale et culturelle. Pour comprendre ce qui, dans cet objet, tient de tout une tradition photographique et artistique qui va de Walker Evans à Chauncey Hare, en passant par Stephen Shore, Lewis Baltz, Robert Adams et Dan Graham, il faut le situer dans la culture américaine, croiser, ne serait-ce que rapidement, l’histoire du droit de la propriété, la sociologie, l’architecture, les American Studies de John Atlee Kouwenhoven et les Landscape Studies des années 1960. Une telle démarche rapproche l’auteure des travaux récents sur cette école de géographie inaugurée par John Brinckerhoff Jackson (Jordi Ballesta), sur la notion de vernaculaire (Clément Chéroux) et plus généralement sur la culture visuelle américaine (François Brunet). Car la photographie n’est jamais un objet purement esthétique. Elle est tout à la fois un outil de promotion immobilière, de conservation du patrimoine, d’enquête sociologique et d’expression artistique. Les ambitions formelles, même des plus grands photographes, ne sont jamais indépendantes de cette « photographie instrumentale » (Allan Sekula) et les artistes tenteront moins de s’en écarter que d’y puiser ironiquement des inspirations formelles – rappelons l’édition de cartes postales par Evans ou Shore, le goût de la frontalité hérité de l’enquête patrimoniale, la référence à la petite annonce immobilière chez Dan Graham (Homes for America, 1966-1967).
L’essai d’Éliane de Larminat s’offre ainsi au lecteur comme un parcours, une traversée de la photographie documentaire et conceptuelle entre les années 1930 et 1990. Dans la première partie, l’auteure revient sur les grandes références littéraires et historiques qui font de la single family detached home un des symboles de la culture américaine depuis le XIXe siècle pour montrer que s’instaure progressivement, sous le regard d’Evans puis de Shore, un véritable genre que Lincoln Kirstein a appelé, en parlant d’Evans, des « portraits de maisons ». Dans la deuxième partie, elle décrit le cycle de la standardisation qui s’enclenche dès les années 1920, avec ses jigsaw houses, ses balloon framed houses, ses shingle style houses (le « style bardeau »), produites par des charpentiers ou des constructeurs locaux (builders) d’après des livres de modèles (pattern books). Elle évoque aussi le cortège de leur détracteurs (pp. 22-23) : avant même que Lewis Mumford ne publie Sticks and Stones (1924), où il dénonce l’uniformisation des constructions américaines, paraît Babbit de Sinclair Lewis, un roman où le personnage éponyme souffre de la standardisation qui touche son logis (p. 57) ; dans les années 1960, cette litanie ne cessera de s’amplifier avec le développement des banlieues et nourrira le discours des sociologues comme William H. White (The Organization Man, 1959), des architectes et théoriciens de l’architecture comme Peter Blake (God’s Own Junkyard, 1964) ou celui des « New Topographics » sur le « paysage altéré par l’homme » (man altered landscape, pp. 70-71). Dans la troisième partie, on passe de la façade aux intérieurs, l’occasion de montrer comment, depuis les années 1930 jusqu’à l’exposition de 1991 Pleasures and Treasures of Domestic Homes organisée par Peter Galassi au MoMA, la photographie documentaire de la maison américaine s’est partagée entre deux genres – les portraits de maisons et les vues d’intérieurs. L’importance des intérieurs est cruciale, dès la Farm Security Administration (FSA), comme réservoir de données culturelles et anthropologiques (p. 127). Ici se croisent la tradition documentaire et les méthodes de l’enquête sociologique que John Collier développera plus tard (pp. 134-135). Objets et mobilier disent beaucoup sur les habitants, à en croire Roy Stryker, le coordinateur de la commande photographique de la FSA. Plus tard, Chauncey Hare fera des portraits d’intérieurs mélancoliques en ajoutant au style documentaire emprunté à Walker Evans une touche sombre et mystique (pp. 140-142).
À travers les trois parties de cet essai se dessine une tradition photographique dont la richesse n’a d’égale que la spécificité de cet objet dans la culture américaine. Plutôt que de refermer la question, ce beau livre ouvre sur de nombreuses problématiques. Retenons trois lignes de tensions qui traversent l’ensemble de l’ouvrage.
La première tend son arc entre la valorisation patrimoniale d’une part et l’éloge de la banalité d’autre part. La logique patrimoniale offre certes, avec Frances Benjamin Johnston ou avec la fameuse commande adressée à Walker Evans par Lincoln Kirstein en 1931, une matrice formelle aux « portraits de maisons » : frontalité ou vues en perspective cavalière, détachement de la maison, lisibilité – toutes ces caractéristiques qui font la spécificité du « style documentaire ». Mais là où l’enquête patrimoniale mettait l’accent sur les monuments saillant de l’architecture victorienne de la Nouvelle-Angleterre, l’approche qui sera plus tard celle d’Evans lui-même cherche à mettre en valeur les éléments vernaculaires dans la banalité. Son attention se porte vers une diversité de formes qui souvent se répètent, sans que la répétition n’entraîne de dégradation du motif. Il suit, selon les mots d’Éliane de Larminat, « une logique de dissémination de l’attention plutôt que de focalisation sur quelques sites exceptionnels » et multiplie ainsi les « lieux à voir » (p. 27). La recherche du vernaculaire se conjugue donc à une valorisation esthétique de la répétition, de la série et des variations géographiques et historiques. Ce regard disséminé est aussi celui de Shore dans ses cartes postales ou de Denise Scott Brown et Robert Venturi lorsque, à la recherche d’un vocabulaire architectural vernaculaire, ils accumulent des observations sur les banlieues américaines, d’abord à Las Vegas puis ailleurs, notamment à Levittown dans le New Jersey. La spécificité de la photographie documentaire réside sans doute dans cette faculté à relever le banal et le quotidien et à s’abstraire de l’illusion de l’authentique.
La deuxième ligne met en tension l’éloge de l’américanité d’un côté et la critique du mauvais goût de l’autre. Certes, quand on pense à la single family house américaine, il nous vient à l’esprit une série de clichés sur l’architecture de mauvais goût typique de l’habitat de classe moyenne de banlieues. Avec ces images, le discours sur la défiguration du paysage, la médiocrité culturelle et l’isolement des habitants. Cette critique ne naît pourtant pas dans les années 1960. Elle est contemporaine des premières séries documentaires valorisant le style vernaculaire. Sous la plume de John Atlee Kouwenhoven, le vernaculaire n’est d’ailleurs pas séparé de la standardisation dont il est en quelque sorte une expression. Aussi, des années 1930 aux années 1990, le regard sur la maison individuelle oscille entre valorisation et dégradation, au point qu’un Robert Adams peut, dans un même mouvement, regretter l’altération du paysage par les humains et chercher, dans les traces mêmes de cette altération, une forme de beauté contemporaine, tandis que Shore et Baltz projettent sur leurs sujets une ironie cinglante. Le partage est parfois difficile à faire entre l’humour deadpan et l’inclination respectueuse des photographes pour la culture de masse.
Enfin, une troisième ligne de tension polarise deux approches de la maison : l’une la traite comme objet architectural, à distance, sans figures humaines, par une description objectiviste de la chose ; l’autre cherche à y pénétrer pour décrire un lieu de vie, un foyer, ses habitants, à travers les objets qui les définissent. Aussi différentes soient-elles, ces deux démarches sont bien souvent complémentaires. En témoigne là encore l’œuvre séminale de Walker Evans, American Photographs (1938), divisée en deux parties, l’une faite de photographies de maison, de monuments et de villes sans personnages, l’autre de vues de rues, d’intérieurs et de portraits. La house et le home ne sont en définitive que deux faces d’un même objet, quoiqu’on puisse parfois déplorer, dans la littérature, dans Babbit par exemple, que tel personnage possède une house sans pouvoir en faire son home par défaut de sens du confort intérieur.
Une des nombreuses qualités de ce passionnant essai est donc de tracer ces lignes à l’intérieur de la tradition documentaire américaine, faisant dialoguer, à plusieurs décennies d’intervalles, des artistes, connus pour la plupart, qui se répondent et s’interprètent mutuellement.
Référence : Christian Joschke, « Éliane de Larminat, Houses and Homes. Photographier la maison aux États-Unis, 1930-1990, 2020 », Transbordeur. Photographie histoire société, no 6, 2022, pp. 178-179.